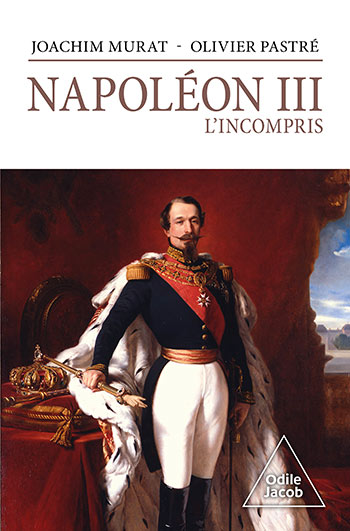L'Histoire de la Monarchie Française
Cette page explore l'évolution fascinante de la monarchie française, en commençant par les rois mérovingiens, les Bourbons, jusqu'à Napoléon III. Découvrez les moments clés, les figures emblématiques et les événements marquants qui ont façonné l'histoire royale de la France à travers les siècles.
Les Mérovingiens (vers 457–751)
La première dynastie franque et la naissance du royaume de France
Mérovée – le fondateur légendaire (vers 447–457)
Mérovée est le roi légendaire dont la dynastie tire son nom. Selon la tradition, il serait un descendant du roi salien Chlodion et d'une créature mythique de la mer, un symbole de la fusion entre l'histoire et le mythe. Il règne sur les Francs Saliens, peuple germanique installé en Belgique actuelle et sur les rives du Rhin.
Son importance historique est surtout symbolique : il marque le début d'une lignée royale stable, reconnaissable par le pouvoir héréditaire et la transmission dynastique.
Childéric Ier (vers 457–481)
Fils de Mérovée, Childéric Ier consolide le royaume franc. Il est connu pour ses exploits militaires et son rôle de fédéré de l'Empire romain : il reçoit des terres et des charges militaires en échange de son service à Rome. Son règne pose les bases de l'autorité franque sur la Belgique et le nord de la France actuelle.
Childéric est enterré à Tournai, et son trésor archéologique, découvert en 1653, révèle la richesse et le pouvoir des rois francs.
Clovis Ier (481–511)
Fils de Childéric, Clovis Ier devient roi des Francs Saliens à 15 ans. Il unifie les différentes tribus franques et étend son royaume sur la quasi-totalité du nord de la Gaule, éliminant les chefs rivaux par la guerre ou la diplomatie.
Clovis est surtout célèbre pour sa conversion au catholicisme vers 496, après sa victoire à la bataille de Tolbiac contre les Alamans. Son baptême à Reims par l'évêque Rémi fonde l'alliance entre la monarchie franque et l'Église catholique, qui sera centrale dans l'histoire de France.
À sa mort en 511, Clovis divise son royaume entre ses quatre fils, selon la tradition franque, mais laisse un héritage durable :
- une dynastie légitime et sacrée,
- une alliance avec l'Église,
- et le concept d'un royaume unique, fondation de la France future.
Les fils de Clovis (511–561)
Après Clovis, le royaume est partagé entre ses quatre fils : Thierry, Clodomir, Childebert, Clotaire Ier.
Clodomir : règne sur Orléans, meurt en guerre contre les Burgondes.
Childebert Ier : règne sur Paris, agrandit le territoire par conquêtes en Provence et en Aquitaine.
Clotaire Ier : finit par réunifier le royaume après la mort de ses frères, consolidant l'autorité mérovingienne.
Cette période voit l'instauration d'une tradition : le partage du royaume entre héritiers, ce qui provoquera souvent guerres civiles et rivalités.
Sigebert Ier, Chilpéric Ier et les guerres internes (561–613)
Après la mort de Clotaire Ier, le royaume est de nouveau partagé. Les fils de Clotaire, notamment Sigebert Ier (Austrasie) et Chilpéric Ier (Neustrie), se livrent à une guerre fratricide, souvent renforcée par les intrigues de leurs épouses, comme Brunehaut, figure politique majeure.
Cette période est marquée par :
- une instabilité chronique,
- des alliances avec les peuples voisins,
- et l'émergence progressive des maires du palais, véritables ministres et gouvernants de fait.
Dagobert Ier (629–639)
Fils de Clotaire II, Dagobert Ier est souvent considéré comme le dernier grand roi mérovingien véritablement puissant. Il centralise le pouvoir, codifie les lois franques et développe l'administration. Sous son règne :
- Paris et Metz deviennent des capitales politiques,
- les relations avec l'Église sont consolidées,
- et le royaume atteint son apogée territoriale.
Après sa mort, les rois deviennent de plus en plus symboliques, et le pouvoir réel glisse vers les maires du palais, ancêtres de la future dynastie carolingienne.
Déclin des Mérovingiens (639–751)
Après Dagobert, les rois mérovingiens deviennent connus comme les "rois fainéants" :
- pouvoir réel limité,
- influence sur le royaume faible,
- les maires du palais contrôlent finances, armée et administration.
Les maires du palais : Clotaire III, Childéric III et Pépin le Bref.
Childéric III (743–751) est le dernier roi mérovingien, roi fantoche sans pouvoir réel.
Pépin le Bref, maire du palais d'Austrasie et fils de Charles Martel, finit par renverser la dynastie.
En 751, avec le soutien du pape Zacharie, Pépin est proclamé roi : la dynastie carolingienne commence, mettant fin à plus de trois siècles de Mérovingiens.
Les Carolingiens (751–987)
(De Pépin le Bref à Hugues Capet : l'Europe naît du royaume franc)
Pépin le Bref (751–768)
Fils de Charles Martel, héros de la bataille de Poitiers (732), Pépin le Bref est maire du palais sous les derniers rois mérovingiens. Voyant que ces rois n'exercent plus aucun pouvoir, il consulte le pape Zacharie : "Mieux vaut-il appeler roi celui qui détient le pouvoir, ou celui qui ne fait rien ?"
Le pape lui répond : "Celui qui détient le pouvoir." Ainsi, Pépin dépose Childéric III et se fait sacrer roi à Soissons en 751, fondant la dynastie carolingienne (du nom de son père, Carolus).
Pépin renforce l'alliance avec Rome : il protège le pape contre les Lombards, et lui offre les territoires de Ravenne, la "donation de Pépin" (754), qui fondent les États pontificaux.
Cette alliance entre le roi franc et la papauté marquera toute la politique médiévale.
Pépin réforme l'administration, impose la justice royale et combat avec succès les Saxons et les Aquitains. Il prépare ainsi le terrain pour son fils Charlemagne, qui élèvera la monarchie franque à un niveau impérial.
Charlemagne (768–814)
Fils de Pépin, Charles Ier, dit Charlemagne, règne d'abord avec son frère Carloman, puis seul après sa mort (771).
C'est un chef de guerre infatigable :
- il conquiert la Saxe, la Bavière, la Lombardie,
- soumet les Aquitains, les Avars, et les Bretons,
- et étend le royaume jusqu'à la Baltique, aux Pyrénées et à l'Adriatique.
Son royaume devient le plus vaste d'Occident depuis l'Empire romain.
Charlemagne n'est pas seulement un conquérant : il se veut défenseur de la foi et restaurateur de l'ordre chrétien. Le 25 décembre 800, à Rome, le pape Léon III le couronne Empereur des Romains. C'est la renaissance de l'Empire d'Occident, huit siècles après la chute de Rome (476).
Charlemagne se voit comme le "père de l'Europe", garant de la foi et de la loi.
Sous son règne :
- il crée une administration centralisée, avec des comtes et des missi dominici (inspecteurs royaux) ;
- il uniformise les lois et la monnaie ;
- il fonde des écoles (école du palais d'Aix-la-Chapelle) et encourage la culture.
C'est la renaissance carolingienne : un renouveau intellectuel et artistique, où les moines copistes, comme Alcuin, préservent la culture antique.
Charlemagne meurt en 814 à Aix-la-Chapelle. Son règne marque le sommet du pouvoir royal en Europe médiévale.
Louis le Pieux (814–840)
Fils unique de Charlemagne, Louis le Pieux hérite d'un empire immense mais difficile à gouverner. Homme pieux et lettré, il tente de moraliser la cour et de maintenir l'unité du royaume sous la foi chrétienne.
Cependant, son autorité est affaiblie par :
- les révoltes de ses fils,
- les querelles religieuses,
- et la lourdeur d'un empire trop vaste.
Avant sa mort, il partage son empire entre ses fils : Lothaire, Louis le Germanique, et Charles le Chauve, ce qui prépare la désintégration politique du monde carolingien.
Après la mort de Louis le Pieux, ses fils se déchirent. La guerre fratricide culmine en 843 avec le traité de Verdun, qui divise l'empire en trois :
- Charles le Chauve : la Francia occidentalis → la future France,
- Louis le Germanique : la Francia orientalis → la future Allemagne,
- Lothaire Ier : la Lotharingie (de la mer du Nord à l'Italie) → zone médiane instable.
Ce traité est fondamental : il dessine les frontières culturelles et linguistiques de l'Europe moderne.
Charles le Chauve (843–877)
Charles le Chauve règne sur la partie occidentale de l'empire. Il doit faire face à de graves menaces :
- les invasions vikings, qui ravagent la vallée de la Seine et pillent Paris,
- les rivalités entre grands seigneurs,
- et l'effritement du pouvoir royal.
Pour défendre le royaume, il distribue des terres en échange du service militaire : c'est le début du système féodal.
En 875, il devient empereur à Rome, mais son autorité reste fragile.
Louis le Bègue, Carloman, Charles le Gros et la fragmentation (877–888)
Après Charles le Chauve, le royaume s'enfonce dans la confusion. Ses successeurs, Louis le Bègue, Carloman II, Charles le Gros, sont faibles ou malades.
L'autorité royale s'effondre :
- les Vikings s'installent durablement en Normandie,
- les seigneurs locaux s'émancipent,
- le pouvoir passe aux mains des ducs et comtes, comme les Robertiens (ancêtres des Capétiens).
Eudes et la défense du royaume (888–898)
Après la déposition de Charles le Gros, les grands du royaume choisissent Eudes, comte de Paris, pour sa bravoure face aux Normands.
Mais la légitimité carolingienne reste forte : à sa mort, la couronne revient à un descendant de Charlemagne, Charles le Simple.
Charles le Simple (898–923)
Charles le Simple tente de restaurer l'autorité royale, mais son pouvoir est limité. Il adopte une politique pragmatique : en 911, il signe le traité de Saint-Clair-sur-Epte avec le chef viking Rollon, lui accordant la Normandie en échange de sa conversion et de sa loyauté.
C'est la naissance du duché de Normandie, qui jouera un rôle immense dans l'histoire future (Guillaume le Conquérant, 1066).
Mais Charles perd le soutien des grands et meurt en captivité. Le royaume se morcelle davantage.
Fin de la dynastie carolingienne (923–987)
Les derniers rois carolingiens, Raoul de Bourgogne, Louis IV d'Outremer, Lothaire, Louis V, ne parviennent plus à imposer leur autorité. Le pouvoir réel appartient aux grands seigneurs féodaux, notamment à la famille des Robertiens, comtes de Paris.
À la mort de Louis V en 987, sans héritier direct, les grands du royaume élisent Hugues Capet, duc des Francs. C'est la fin des Carolingiens et le début de la dynastie capétienne, qui régnera jusqu'à la Révolution.
Les Capétiens (987–1328)
(Hugues Capet à Charles IV : la construction de la monarchie française)
Hugues Capet (987–996)
En 987, à la mort du dernier carolingien Louis V, les grands du royaume élisent Hugues Capet, puissant duc d'Île-de-France et comte de Paris. Ce choix illustre la réalité politique : le pouvoir effectif ne réside plus nécessairement dans la seule lignée carolingienne mais dans les seigneurs qui tiennent Paris et ses environs. Hugues obtient le sacre, pose les éléments d'une légitimité dynastique neuve et, surtout, œuvre pour assurer la succession en faisant sacrer son fils Robert, pratique qui deviendra caractéristique des Capétiens : sacrer le vivant héritier pour cimenter la continuité. Le domaine royal est encore modeste (autour de l'Île-de-France), mais la maison capétienne a posé le principe d'une royauté héréditaire durable.
Robert II le Pieux (996–1031)
Fils d'Hugues, Robert II poursuit l'affirmation dynastique. Son surnom, le Pieux, renvoie à sa piété et à ses fréquents conflits avec l'Église, notamment pour motifs matrimoniaux (divorces, remariages jugés illégitimes). Robert cherche à asseoir l'autorité royale face aux grands seigneurs et à renforcer la légitimité capétienne par le sacre et la piété publique. Son règne illustre la difficulté pour un roi et sa maison de transformer une seigneurie parisienne en véritable monarchie territoriale : l'influence reste limitée, la réalité du pouvoir repose encore sur le consentement des grands.
Henri Iᵉʳ (1031–1060)
Henri Iᵉʳ, fils de Robert II, hérite d'un royaume fragile. Son règne est marqué par l'émergence d'acteurs puissants, les ducs de Normandie, les comtes de Blois et de Champagne, et par les tensions frontalières avec la Normandie. Henri doit ménager ses relations avec Guillaume de Normandie tout en tentant d'affirmer une justice royale croissante : il confirme et étend le droit coutumier dans l'Île-de-France. Sa politique est de gestion prudente : il consolide progressivement l'autorité capétienne sans transformations spectaculaires.
Philippe Iᵉʳ (1060–1108)
Philippe Iᵉʳ règne plus de quarante-sept ans. Victorieux dans l'alliance ou l'opposition ponctuelle avec les ducs normands et les grands féodaux, il voit toutefois la puissance réelle du roi limitée ; les territoires et obéissances se maintiennent largement localisés. Le roi est critiqué pour sa vie privée (remariage avec Bertrade de Montfort), ce qui entraîne un exil momentané et l'embarras de la couronne devant l'Église. Néanmoins, le long règne de Philippe stabilise la succession et permet à ses successeurs d'affirmer plus sereinement la puissance capétienne.
Louis VI le Gros (1108–1137)
Avec Louis VI, la royauté capétienne change de ton. Surnommé le Gros, Louis apparaît comme le roi combattant les seigneurs indépendants : il mènent une politique résolue contre les féodaux brigands (les seigneurs féodaux qui rançonnent routes et campagnes). Il consolide l'autorité du roi autour de Paris, protège les communes naissantes, encourage les abbayes et la réforme ecclésiastique, et s'appuie sur des alliances avec des milieux urbains et ecclésiastiques. Louis VI affermit l'appareil judiciaire royal et la présence du roi dans le domaine capétien : Paris devient plus nettement le centre de gravité du pouvoir.
Louis VII le Jeune (1137–1180)
Louis VII, fils de Louis VI, connaît un règne contrasté : il participe à la Deuxième Croisade (1147–1149), une expédition européenne pénible qui s'achève en échec et ternit son prestige. Politiquement, son plus grand évènement intime a des conséquences gigantesques : son mariage avec Aliénor d'Aquitaine (1152) puis leur divorce la même année entraînent la perte d'Aquitaine au profit d'Henri II Plantagenêt lorsque celle-ci épouse le duc d'Aquitaine et futur roi d'Angleterre. Cette perte territoriale, une immense province du Sud-Ouest, affaiblit durablement la politique capétienne et ouvre un conflit prolongé avec la dynastie angevine. Louis poursuit néanmoins la centralisation juridique et soutient le rayonnement intellectuel et religieux (fondation d'abbayes, soutien aux ordres nouveaux).
Philippe II Auguste (1180–1223)
Philip II, dit Augustus, est l'un des grands fondateurs de la monarchie française. Son règne marque une rupture : par la diplomatie, la guerre et l'administration, il multiplie et consolide les possessions royales. Profitant des conflits intérieurs des Plantagenêts (la maison d'Angleterre), il reprend progressivement la Normandie, l'Anjou, et d'importants territoires en 1204 et ensuite. Sa victoire diplomatique et militaire culmine à la bataille de Bouvines (1214), victoire décisive contre une coalition anglo-impériale qui renforce la légitimité royale.
Sur le plan administratif, Philippe II met en place une organisation de plus en plus professionnelle : mise en place des baillis et sénéchaux (agents royaux chargés de justice et de collecte fiscale), défense du domaine royal, urbanisme (il développe Paris) et fiscalité orchestrée. Il affine l'appareil monarchique et pose les bases d'un État plus cohérent.
Louis VIII le Lion (1223–1226)
Louis VIII, fils de Philippe II, règne peu mais poursuit la politique paternelle. Déjà proclamé roi d'Angleterre par des barons anglais hostiles à Jean sans Terre (1216) lors de la révolte des barons, il ne consolide pas cette position. En France, il intervient vigoureusement dans le Languedoc (après la croisade contre les Albigeois), renforce la royauté et prépare la régence de sa veuve Blanche de Castille qui suivra la mort prématurée de Louis VIII.
Louis IX (Saint Louis) (1226–1270)
Louis IX, devenu roi enfant, voit la régence de sa mère Blanche de Castille (régente de 1226 à 1234) assurer la stabilité. Louis IX incarne la formule du roi chevalier et chrétien : profondément religieux, juste et impartial, il réforme la justice (renforce l'idée de justice royale, instaure tribunaux, veille à la protection des pauvres), fonde et institutionnalise des pratiques judiciaires (il promeut le Parlement de Paris qui devient cour souveraine), et est célèbre pour sa lutte contre l'injustice féodale.
Sur le plan matériel, il fait bâtir la Sainte-Chapelle (pour conserver les reliques de la Passion), réforme la monnaie et administre avec sérieux. Louis IX mène deux croisades : la Septième croisade (1248–1254) et la Huitième croisade (1270), lors de laquelle il meurt à Tunis. Il est canonisé en 1297, devenant Saint Louis, modèle de souverain chrétien. Son règne a fortifié la légitimité morale de la monarchie et affermi les institutions judiciaires.
Philippe III le Hardi (1270–1285)
Philippe III, fils de Louis IX, poursuit la politique royale, mais son règne est moins éclatant. Il agrandit le domaine royal par des acquisitions et marie habilement ses enfants pour consolider les alliances. Sur le plan militaire, il engage la France dans l'expédition contre l'Aragon (l'Aragonese Crusade) en 1284–1285, entreprise malheureuse liée au conflit sicilien ; l'expédition se solde par des pertes lourdes et la mort de Philippe III en 1285. Son règne montre les limites de l'intervention militaire lointaine et l'importance des alliances dynastiques.
Philippe IV le Bel (1285–1314)
Philippe IV, dit le Bel, est un administrateur énergique qui représente l'apogée d'un État royal fort au tournant des XIIIᵉ–XIVᵉ siècles. Il renforce l'administration royale (bureaucratie centralisée, contrôles fiscaux), impose de nouvelles taxes pour financer dépenses et armées, et développe un appareil juridique raffiné.
Politiquement, il entre en conflit ouvert avec la papauté : sa querelle avec Boniface VIII sur la fiscalité du clergé et la préséance royale culmine dans l'épisode d'Anagni (1303) et la mise en cause de l'autorité papale. Philippe convie en 1302 les États généraux, assemblée rassemblant clergé, noblesse et tiers état, acte fondateur de la tradition représentative royale, mobilisée au besoin pour légitimer les décisions fiscales.
Sur le plan religieux et financier, Philippe s'attaque aux Templiers (1307), accusés et finalement dissous par décision papale en 1312 ; Philippe confisque leurs biens, renforçant le trésor royal (mais marquant aussi l'arbitraire monarchique). Il réforme la monnaie et tente d'assurer la solvabilité du royaume.
La politique fiscale et les exactions faites pour renflouer les finances provoquent des tensions, et sa politique dynastique (trois fils qui lui succéderont) n'empêchera pas une crise de succession. Philippe meurt en 1314, laissant l'État puissant mais économiquement sous pression.
Louis X le Hutin (1314–1316)
Louis X, fils de Philippe IV, hérite d'un royaume fort mais fragilisé financièrement. Son règne est bref (1314–1316). On lui reconnaît quelques mesures populaires : par exemple, il émancipe certains serfs sur ses domaines et prononce des actes favorables aux commerçants (soulagement fiscal ponctuel), gestes destinés à apaiser les tensions urbaines. Il meurt brusquement en 1316. Sa mort ouvre une crise dynastique : son épouse, enceinte, donnera naissance à Jean Iᵉʳ, enfant posthume qui ne vit que quelques jours.
Jean Iᵉʳ (janvier 1316)
Né après la mort de Louis X, Jean Iᵉʳ ne survit que quelques jours (janvier 1316). Sa disparition immédiate accentue la crise de succession capétienne et déclenche le débat sur l'éligibilité des femmes au trône.
Philippe V le Long (1316–1322)
Philippe V, frère de Louis X, est reconnu roi en 1316. Sa décision politique la plus durable est d'écarter la fille de Louis X (Jeanne) de la succession et d'insister pour qu'un homme lui succède ; en pratique, il affirme la primauté de la succession masculine. Les juristes et les pairs valideront ce principe : cette pratique, consolidée officiellement en 1317, servira de base à la future exclusion des femmes au profit des héritiers mâles (source par la suite appelée « loi salique » dans la tradition politique française). Philippe V réforme aussi l'administration fiscale, cherche à stabiliser les finances et meurt en 1322 sans fils mâle survivant.
Charles IV le Bel (1322–1328)
Charles IV, dernier fils survivant de Philippe IV, assume la couronne en 1322. Son règne est marqué par difficultés politiques et financières et par la question de la succession : Charles n'a pas d'héritier mâle survivant. À sa mort en 1328 s'éteint la lignée capétienne directe. La couronne passe alors, selon la décision des grands et des pairs, à Philippe de Valois (neveu de Philippe IV), qui devient Philippe VI, inaugurant la maison de Valois.
La fin de Charles IV provoque une crise dynastique majeure : Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe IV par sa mère Isabelle (fille de Philippe IV), revendique la couronne, mais les barons français privilégient l'ascendance masculine agnatique et choisissent la branche Valois. Cette exclusion sera l'un des éléments déclencheurs des tensions conduisant, quelques années plus tard, à la guerre de Cent Ans (1337–1453).
Les Valois (1328–1589)
(De Philippe VI à Henri III : la monarchie française entre guerre, renaissance et tragédie)
Philippe VI de Valois (1328–1350)
À la mort de Charles IV le Bel en 1328, la lignée directe des Capétiens s'éteint. Les grands du royaume élisent Philippe de Valois, cousin du défunt roi, fils de Charles de Valois (frère de Philippe IV le Bel). Son accession écarte Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe IV par sa mère Isabelle. Mais cette décision crée une contestation durable : Édouard revendique la couronne de France, déclenchant la guerre de Cent Ans (1337–1453).
La guerre, d'abord féodale et dynastique, s'enracine vite dans une lutte pour la souveraineté territoriale. Les Anglais remportent de grands succès : victoire de Crécy (1346), où la chevalerie française est écrasée par les archers anglais. En 1347, Calais tombe aux mains de l'Angleterre et restera anglaise pendant deux siècles.
Le règne de Philippe VI est aussi marqué par la peste noire (1348), qui décime près du tiers de la population du royaume. Le pouvoir royal, affaibli par la guerre et les finances épuisées, est contesté. À sa mort en 1350, Philippe laisse un royaume en crise, mais la dynastie Valois s'impose durablement.
Jean II le Bon (1350–1364)
Fils de Philippe VI, Jean II hérite d'un royaume épuisé. Chevalier courageux mais piètre stratège, il affronte les Anglais commandés par le Prince Noir.
La bataille de Poitiers (1356) est une catastrophe : Jean II est fait prisonnier et emmené à Londres. Son fils, le Dauphin Charles, assure la régence dans un climat de crise :
- Révolte des États généraux (menés par Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris),
- Jacqueries paysannes contre les seigneurs,
- effondrement économique et monétaire.
Jean signe le traité de Brétigny (1360), cédant d'immenses territoires au roi d'Angleterre Édouard III (Aquitaine, Poitou, etc.). Rentré en France, il repart en captivité par honneur, et meurt à Londres en 1364.
Charles V le Sage (1364–1380)
Fils de Jean II, Charles V est l'un des souverains les plus intelligents et les plus stratèges de la dynastie. Son règne marque une renaissance politique, militaire et administrative après les désastres précédents.
Charles V réorganise les finances, réforme la monnaie, restaure l'ordre intérieur. Il s'entoure de conseillers compétents, notamment du connétable Bertrand du Guesclin, son grand chef de guerre. Grâce à ce dernier, les Anglais sont peu à peu repoussés : à la mort de Charles V, la France a reconquis la quasi-totalité des terres perdues.
Charles V est aussi un roi intellectuel : il fonde la bibliothèque royale du Louvre, encourage la traduction d'ouvrages savants et fait de Paris un centre du savoir. Surnommé le Sage, il incarne le modèle du monarque moderne : prudent, organisé et réformateur.
Charles VI (1380–1422)
Monté sur le trône à 11 ans, Charles VI débute sous la régence de ses oncles (les ducs de Bourgogne, de Berry et d'Anjou), qui se disputent le pouvoir. Au début, Charles gouverne avec succès (victoire de Roosebeke, 1382), mais en 1392 il est frappé par des crises de folie récurrentes.
La folie du roi provoque un effondrement de l'autorité. Deux factions s'affrontent :
- les Armagnacs, partisans du Dauphin (héritier royal),
- les Bourguignons, alliés des Anglais.
En 1415, la France subit une nouvelle défaite écrasante à Azincourt, où la chevalerie française est décimée par les archers anglais.
Sous l'influence de la reine Isabeau de Bavière et du duc de Bourgogne, Charles VI signe le traité de Troyes :
- il désavoue son fils,
reconnaît Henri V d'Angleterre comme héritier du trône de France.
C'est le point le plus bas de la monarchie française : la France est partagée entre Anglais et Bourguignons. Charles VI meurt en 1422, laissant un royaume en ruine et un fils déshérité… le futur Charles VII.
Charles VII (1422–1461)
Le début du règne de Charles VII est dramatique : il n'est reconnu que dans le sud du royaume, tandis que les Anglais occupent Paris et le nord. Mais le destin du royaume bascule grâce à Jeanne d'Arc, jeune paysanne de Lorraine, qui convainc le roi de reprendre l'offensive.
Sous l'inspiration de Jeanne, l'armée française libère Orléans (1429), puis ouvre la route de Reims, où Charles est sacré roi. C'est un tournant symbolique : la légitimité capétienne renaît. Jeanne, capturée par les Bourguignons, est livrée aux Anglais et brûlée vive à Rouen (1431). Mais sa mission est accomplie : elle a restauré l'espoir et la légitimité du roi.
Charles VII, conseillé par Jacques Cœur et ses capitaines, réorganise l'armée (création des compagnies d'ordonnance, première armée permanente), réforme les impôts (taille royale), et rétablit l'autorité monarchique. Il achève la guerre de Cent Ans : en 1453, après la victoire de Castillon, les Anglais ne conservent plus que Calais.
Charles VII laisse à sa mort un royaume restauré et une monarchie puissante.
Louis XI (1461–1483)
Fils de Charles VII, Louis XI poursuit et accélère la centralisation. Habile, rusé et souvent impitoyable, il tisse un réseau de diplomatie et d'espionnage qui lui vaut le surnom de roi araignée.
Il affronte la Ligue du Bien public (1465), coalition de grands seigneurs menée par Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Après de longues luttes, il parvient à annexer la Bourgogne (1477) à la mort de Charles le Téméraire, puis la Picardie et la Provence. Louis XI accroît considérablement le domaine royal.
Il favorise les bourgeois, développe les routes et le commerce, crée des relais de poste, soutient les villes. Par sa politique d'économie et de diplomatie, il consolide un État centralisé, efficace et indépendant de la noblesse. À sa mort, la France est solide et unifiée.
Charles VIII (1483–1498)
Fils de Louis XI, Charles VIII hérite d'un royaume pacifié, sous la régence prudente de Anne de Beaujeu. En 1491, il épouse Anne de Bretagne, scellant l'union progressive de la Bretagne à la France.
Charles, fasciné par les arts et la gloire, revendique le royaume de Naples et lance la première guerre d'Italie. Il conquiert Naples en 1495, mais doit rapidement se retirer. L'expédition ruineuse inaugure une longue série de guerres italiennes qui marqueront les règnes suivants. Charles VIII meurt accidentellement en 1498, sans héritier mâle.
Louis XII (1498–1515)
Cousin de Charles VIII, Louis XII devient roi. Il épouse à son tour Anne de Bretagne, maintenant définitivement la Bretagne dans le royaume.
Soucieux de justice et d'économie, Louis XII allège les impôts, réforme la justice et protège les villes : le peuple le surnomme le "Père du peuple".
Il poursuit les ambitions italiennes : conquiert Milan (1499), mais subit des revers face à la coalition hispano-impériale. Ses campagnes laissent la France affaiblie sur le plan militaire, mais enrichie artistiquement et culturellement.
François Ier (1515–1547)
Petit-fils de Louis d'Orléans, François Ier incarne la Renaissance française : humaniste, mécène et chevalier.
Dès 1515, il remporte la célèbre victoire de Marignan, qui lui assure Milan et la gloire. Mais la rivalité avec Charles Quint, empereur d'Allemagne et roi d'Espagne, marque tout son règne. Capturé à Pavie (1525), François Ier signe un traité humiliant, puis le renie à son retour.
François Ier transforme la cour : il fait venir Léonard de Vinci, construit Chambord, fonde le Collège de France et favorise l'imprimerie et la langue française. Il centralise aussi l'administration et réforme la justice.
François Ier obtient du pape le droit de nommer les évêques et abbés de France, un pas décisif vers le contrôle royal de l'Église nationale. Il meurt en 1547, laissant un royaume puissant et culturellement rayonnant.
Henri II (1547–1559)
Fils de François Ier, Henri II poursuit la rivalité avec Charles Quint et son fils Philippe II d'Espagne. Les guerres d'Italie se terminent par la paix du Cateau-Cambrésis (1559) : la France renonce à l'Italie mais conserve Metz, Toul et Verdun.
Henri II renforce l'autorité royale, poursuit la répression des protestants (huguenots), et s'appuie sur la puissante famille de Guise. Il meurt accidentellement lors d'un tournoi, laissant quatre fils mineurs, événement tragique qui ouvrira une période de chaos.
François II (1559–1560)
Fils aîné d'Henri II, François II épouse Marie Stuart, reine d'Écosse. Trop jeune, il est dominé par ses oncles François et Charles de Guise, ultra-catholiques, qui gouvernent en son nom. Son court règne voit la conjuration d'Amboise (1560), complot protestant réprimé avec violence. Il meurt à 16 ans, ouvrant la voie à son frère cadet Charles IX.
Charles IX (1560–1574)
Sous la régence de Catherine de Médicis, mère du roi, la France est divisée entre catholiques et protestants (huguenots). Malgré des tentatives de conciliation (édit de janvier 1562), les guerres de Religion éclatent.
Le 24 août 1572, à Paris, après le mariage de sa sœur Marguerite de Valois avec le protestant Henri de Navarre, une grande tuerie des protestants est déclenchée : des milliers de morts. Charles IX, probablement manipulé par son entourage, en sort bouleversé. Il meurt jeune, rongé par la maladie et le remords.
Henri III (1574–1589)
Dernier fils d'Henri II, Henri III hérite d'un royaume ravagé par la guerre civile. Intelligent, cultivé et raffiné, il tente de restaurer l'ordre par la négociation et des réformes morales.
Mais la Ligue catholique, menée par le duc de Guise, s'oppose à lui avec violence. En 1588, Henri fait assassiner le duc et le cardinal de Guise à Blois, provoquant un scandale. Excommunié et isolé, Henri III s'allie au roi protestant Henri de Navarre contre la Ligue. Peu après, il est assassiné en 1589 par un moine fanatique, Jacques Clément.
Sa mort sans héritier mâle marque la fin de la dynastie des Valois. Le trône revient à Henri de Navarre, qui deviendra Henri IV, premier roi de la maison de Bourbon.
La Maison de Bourbon (1589–1792)
(De Henri IV à Louis XVI – La grandeur et la chute de la monarchie absolue française)
Henri IV (1589–1610)
Henri IV, roi de Navarre et descendant direct de Saint Louis par une branche cadette, accède au trône de France à la mort d'Henri III (1589). Mais le royaume est déchiré : les guerres de Religion opposent catholiques et protestants depuis plus de trente ans. Henri, chef du parti protestant, doit d'abord conquérir son royaume.
Pendant plusieurs années, il affronte la Ligue catholique, soutenue par l'Espagne. Progressivement, il reprend les villes du royaume, mais comprend qu'il ne pourra régner en paix sans rallier les catholiques. En 1593, il se convertit au catholicisme, un acte politique majeur résumé par la célèbre phrase : "Paris vaut bien une messe." Il est sacré roi de France à Chartres en 1594.
Henri IV comprend que la France a besoin de paix et de reconstruction. En 1598, il signe l'édit de Nantes, qui accorde :
- la liberté de culte aux protestants dans certaines villes,
- la tolérance religieuse et la paix civile.
C'est un geste audacieux et inédit dans l'Europe du XVIᵉ siècle.
Avec son ministre Maximilien de Béthune, duc de Sully, Henri IV restaure les finances publiques :
- réduction des dettes de l'État,
- soutien à l'agriculture,
- amélioration des routes et du commerce,
- lancement de grands travaux et encouragement des manufactures.
Henri IV veut une France prospère et un peuple heureux. Il déclare : "Je veux que chaque laboureur puisse mettre la poule au pot le dimanche."
Le 14 mai 1610, Henri IV est assassiné à Paris par François Ravaillac, un fanatique. Sa mort plonge la France dans la douleur. Il laisse l'image d'un roi humain, pragmatique, et fondateur de la stabilité bourbonienne.
Louis XIII (1610–1643)
Louis XIII n'a que 9 ans quand son père meurt. Sa mère, Marie de Médicis, exerce la régence, s'appuyant sur des conseillers italiens impopulaires, notamment Concini, dont la domination provoque une révolte nobiliaire.
En 1617, Louis XIII prend le pouvoir avec l'aide de son favori Charles d'Albert, duc de Luynes, et fait exécuter Concini : c'est son premier acte de souverain.
En 1624, Louis XIII s'attache les services du cardinal de Richelieu, homme d'État visionnaire. Ensemble, ils posent les fondations de la monarchie absolue. Richelieu a trois grands objectifs :
Briser la puissance de la noblesse, en supprimant les révoltes et les duels.
Soumettre les protestants, en détruisant leurs places fortes (siège de La Rochelle, 1628).
Affirmer la puissance de la France en Europe, en s'opposant aux Habsbourg d'Espagne et d'Autriche.
La France entre ainsi dans la guerre de Trente Ans (1635), aux côtés des puissances protestantes, par pure raison d'État : la religion passe après les intérêts du royaume.
Louis XIII n'a pas le charisme de son père, mais il a la rigueur du devoir. Son règne, autoritaire et sobre, consolide l'autorité royale. Quand il meurt en 1643, il laisse un héritier de cinq ans : Louis XIV. Le pouvoir royal, désormais centralisé, est solidement établi.
Louis XIV (1643–1715)
La régence est assurée par Anne d'Autriche, mère du jeune roi, et par le cardinal Mazarin. Mais la noblesse et les parlements se soulèvent contre l'autorité royale : c'est la Fronde (1648–1653). Ce traumatisme marque à jamais le jeune Louis : il ne supportera plus jamais la désobéissance.
En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV déclare : "L'État, c'est moi."
Il gouverne seul, avec l'aide de ministres compétents (Colbert, Louvois, Le Tellier, Vauban). Sous son règne, la monarchie atteint son apogée de puissance, d'ordre et de prestige.
Louis XIV fait construire le château de Versailles, symbole du rayonnement monarchique. Il y fixe la noblesse, qu'il contrôle par l'étiquette et le faste. Versailles devient le centre politique, artistique et culturel de l'Europe.
Avec Colbert, le roi réforme :
- les finances et la fiscalité,
- le commerce maritime,
- les manufactures royales (tapisseries, soieries, verreries),
- les routes et canaux (canal du Midi).
C'est l'ère du colbertisme : le mercantilisme à la française.
Louis XIV veut la gloire militaire et la sécurité des frontières :
- Guerre de Dévolution (1667–68),
- Guerre de Hollande (1672–78),
- Guerre de la Ligue d'Augsbourg (1688–97),
- Guerre de Succession d'Espagne (1701–1714).
Les premières sont victorieuses ; les dernières épuisent le royaume. La France sort agrandie mais ruinée.
Louis XIV veut l'unité religieuse :
- Révocation de l'édit de Nantes (1685), persécutant les protestants,
- lutte contre le jansénisme.
Cette politique fragilise l'économie (fuite de milliers d'artisans protestants).
Louis XIV meurt en 1715, après 72 ans de règne, un record inégalé. Son arrière-petit-fils, Louis XV, hérite d'un royaume puissant mais épuisé.
Louis XV (1715–1774)
Sous la régence du duc d'Orléans (1715–1723), la France expérimente une politique plus libérale. Le système de John Law, visant à réformer les finances, s'effondre en 1720 et discrédite le pouvoir.
Sous le cardinal de Fleury, le royaume retrouve stabilité et prospérité. Mais après sa mort, Louis XV gouverne seul, influencé par ses favorites.
Louis XV connaît de grands succès militaires, comme à Fontenoy (1745), mais aussi de lourdes défaites : la guerre de Sept Ans (1756–1763) fait perdre à la France son empire colonial (Canada, Inde).
Le roi s'isole à Versailles, entouré de ses favorites :
- Madame de Pompadour, protectrice des arts et des philosophes,
- Madame du Barry, symbole du luxe décadent.
La cour devient synonyme de corruption et de dépenses excessives.
Les parlements, corps de magistrats nobles, s'opposent de plus en plus à la monarchie, notamment sur les questions fiscales et religieuses. Louis XV les exile, mais son autorité s'érode.
Le "Bien-Aimé" devient impopulaire. À sa mort en 1774, le prestige du trône est gravement atteint.
Louis XVI (1774–1792)
Louis XVI, petit-fils de Louis XV, monte sur le trône à 20 ans. Marié à Marie-Antoinette d'Autriche, il est honnête et travailleur, mais manque de décision. Le royaume est endetté et gangrené par les privilèges.
Louis XVI tente de réformer avec Turgot, Necker, et Calonne : abolition des corvées, réforme fiscale, liberté du commerce… Mais la noblesse et le clergé refusent de céder leurs privilèges.
Pour résoudre la crise, il convoque les États généraux en 1789 — les premiers depuis 1614.
Les États généraux se transforment en Assemblée nationale. Le roi perd progressivement le contrôle :
- prise de la Bastille (14 juillet 1789),
- abolition des privilèges,
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Louis XVI est contraint de quitter Versailles pour Paris (octobre 1789). Sa fuite à Varennes (1791) ruine sa popularité.
En août 1792, la monarchie est abolie. Le roi est jugé pour trahison et guillotiné le 21 janvier 1793. Sa mort marque la fin de la monarchie millénaire des Capétiens, Valois et Bourbons.
La Maison Bonaparte (1799–1815)
(Le génie, l'empereur, et le mythe : La France révolutionnaire devenue empire)
Napoléon Ier (1799-1815)
Napoléon Bonaparte naît le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, tout juste annexée à la France. Issu d'une petite noblesse insulaire, il reçoit une éducation militaire en métropole, à Brienne, puis à l'École militaire de Paris. C'est un esprit brillant, ambitieux, passionné par les sciences, l'histoire, et les grands stratèges de l'Antiquité.
Sous la Révolution, la guerre donne leur chance aux talents nouveaux. Bonaparte, officier d'artillerie, se distingue en 1793 lors du siège de Toulon, repris aux royalistes avec l'aide britannique : il a alors 24 ans.
Envoyé en Italie, il prend le commandement de l'armée d'Italie en 1796. Sa campagne d'Italie (1796–1797) est un chef-d'œuvre : il bat les Autrichiens, libère le nord de l'Italie, et signe la paix de Campo-Formio, qui agrandit la France.
Cherchant à frapper l'Angleterre en coupant sa route vers l'Inde, Bonaparte conduit une expédition en Égypte. Il remporte la bataille des Pyramides, mais sa flotte est détruite par Nelson à Aboukir. Malgré le revers, il ramène d'Égypte une aura de conquérant et de savant : l'expédition contribue à la naissance de l'égyptologie.
De retour en France, Bonaparte profite du discrédit du Directoire. Le 18 Brumaire an VIII, il renverse le gouvernement et établit le Consulat, avec lui-même comme Premier Consul. Il déclare : "Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée : elle est finie."
C'est le début d'un régime autoritaire, mais efficace.
Le Consulat met en place des réformes durables :
- Le Code civil (1804), garantissant l'égalité civile et la propriété, encore en vigueur aujourd'hui.
- La Banque de France (1800), pour stabiliser la monnaie.
- Les lycées et la Légion d'honneur, pour récompenser le mérite.
- Le Concordat (1801) avec le pape Pie VII, qui rétablit la paix religieuse.
- La centralisation administrative, avec les préfets et les maires nommés.
Napoléon reconstruit la France sur des bases solides, réconciliant l'ordre et la Révolution.
Pour consolider son pouvoir, Bonaparte repart en guerre contre l'Autriche. Sa victoire à Marengo (1800) lui vaut un prestige immense : il est désormais maître de la France et héros de l'Europe.
En 1802, il devient Premier Consul à vie ; deux ans plus tard, la France le proclame Empereur des Français. Le 2 décembre 1804, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, il se couronne lui-même, en présence du pape Pie VII : "Napoléon Ier, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, empereur des Français."
Napoléon crée un Empire administratif efficace :
- préfets, juges, fonctionnaires, armée impériale : tout dépend de lui.
- noblesse d'Empire (ducs, comtes, barons) fondée sur le mérite.
- propagande et cérémonial fastueux pour asseoir la légitimité dynastique.
En 1804, il fait adopter le Code civil, qui unifie le droit français et incarne la modernité légale et sociale. C'est l'un de ses plus grands héritages.
Napoléon affronte presque toute l'Europe coalisée. De 1805 à 1809, il remporte une série de victoires éclatantes :
Austerlitz (1805) : la "bataille des Trois Empereurs", triomphe contre la Russie et l'Autriche.
Iéna et Auerstaedt (1806) : écrasement de la Prusse.
Friedland (1807) : victoire contre la Russie, suivie du traité de Tilsit.
L'Europe est remodelée à sa guise :
- création du Royaume d'Italie, de la Confédération du Rhin, du Duché de Varsovie,
- mise sur le trône de ses frères (Joseph à Naples puis en Espagne, Louis en Hollande, Jérôme en Westphalie).
Napoléon se veut le nouvel empereur des Lumières, unifiant l'Europe sous le modèle français.
Pour vaincre l'Angleterre, invincible sur mer, Napoléon décrète le blocus continental, interdisant le commerce avec les Britanniques. Mais la mesure ruine le commerce européen et suscite le mécontentement.
À partir de 1808, l'Empire s'essouffle :
Guerre d'Espagne : résistance acharnée et guérillas qui épuisent les armées.
Campagne de Russie (1812) : désastre monumental.
La bataille de la Moskova (septembre 1812) est indécise, et la retraite de Russie anéantit la Grande Armée : sur 600 000 hommes, moins de 100 000 reviennent.
L'Europe entière se coalise de nouveau contre lui : Leipzig (1813), "bataille des Nations" : défaite décisive.
En 1814, les Alliés envahissent la France. Napoléon abdique à Fontainebleau (6 avril 1814) et part en exil sur l'île d'Elbe.
En mars 1815, Napoléon s'échappe d'Elbe et débarque à Golfe-Juan. En marchant sur Paris, il rallie les troupes envoyées contre lui : "Soldats, me voici ! Reconnaissez votre empereur !" Louis XVIII s'enfuit : Napoléon reprend le pouvoir pour Cent Jours.
Face à une nouvelle coalition menée par l'Angleterre et la Prusse, il livre sa dernière bataille à Waterloo, en Belgique. Malgré son génie tactique, la supériorité numérique ennemie l'emporte. L'armée française est défaite.
Napoléon abdique à nouveau et est déporté par les Anglais sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud. Il y vit en captivité jusqu'à sa mort, le 5 mai 1821.
La Restauration bourbonienne (1814–1830)
(Entre légitimité royale et héritage révolutionnaire)
En avril 1814, après la campagne de France et l'entrée des Alliés à Paris, Napoléon Ier abdique. Les puissances victorieuses, Autriche, Russie, Prusse et Angleterre, veulent rétablir la monarchie en France, mais une monarchie capable de stabiliser le pays après vingt-cinq ans de guerres et de révolutions.
Elles choisissent Louis-Stanislas-Xavier de Bourbon, frère cadet de Louis XVI, en exil depuis 1791. Il devient Louis XVIII, roi de France et de Navarre.
Louis XVIII (1814–1824)
Louis XVIII, âgé de 59 ans, est cultivé, intelligent, modéré. Il comprend que le retour pur et simple à l'Ancien Régime est impossible. Il accepte donc de régner selon une Charte constitutionnelle, promulguée le 4 juin 1814.
Cette Charte, octroyée par le roi, cherche à concilier l'ordre monarchique et les conquêtes de 1789. Elle établit :
- un roi héréditaire, chef de l'exécutif ;
- un Parlement bicaméral : la Chambre des pairs (noblesse) et la Chambre des députés (élus par suffrage censitaire) ;
- la liberté religieuse, l'égalité devant la loi, la conservation du Code civil et des biens nationaux.
Ainsi, Louis XVIII se pose en roi constitutionnel, garant de la stabilité.
Mais le rétablissement est interrompu par un événement inattendu : le retour de Napoléon. En mars 1815, l'Empereur débarque de l'île d'Elbe et reprend le pouvoir pour Cent Jours. Louis XVIII s'enfuit à Gand (Belgique). Après Waterloo (juin 1815) et la seconde abdication de Napoléon, le roi rentre définitivement à Paris.
Louis XVIII doit faire face à un pays divisé :
- les royalistes ultras réclament vengeance contre les "traîtres" de l'Empire,
- les libéraux veulent des réformes.
Entre 1815 et 1816, c'est la Terreur blanche : persécutions et exécutions de bonapartistes (dont le maréchal Ney).
Mais Louis XVIII impose rapidement la modération. Il dissout la Chambre ultra-royaliste en 1816 et favorise un gouvernement plus libéral.
Sous son règne :
- l'administration et la justice sont stabilisées,
- les finances rétablies (grâce à Villèle et Decazes),
- la France réintègre la scène européenne.
En 1823, la France mène une expédition en Espagne pour rétablir le roi Ferdinand VII, succès qui renforce le prestige royal.
Louis XVIII meurt le 16 septembre 1824, sans enfants. Son règne, calme et prudent, a su réconcilier la France monarchique et la France révolutionnaire. Il laisse le trône à son frère, le comte d'Artois, devenu Charles X.
Charles X (1824–1830)
Charles X, ancien émigré, est profondément catholique, royaliste et conservateur. Il a vécu la Révolution comme un traumatisme et veut restaurer la monarchie de droit divin. Il ne comprend pas le monde nouveau issu de 1789.
Son couronnement à Reims (1825), dans la cathédrale des rois, marque un retour symbolique à l'Ancien Régime. Mais ce geste choque une partie du peuple et de la bourgeoisie.
Sous son règne, le gouvernement est dominé par les ultras, menés par Joseph de Villèle. Le pouvoir entreprend plusieurs réformes réactionnaires :
- indemnisation des émigrés spoliés pendant la Révolution,
- loi du sacrilège (1825) punissant de mort la profanation des hosties,
- renforcement de l'influence du clergé dans l'éducation.
Ces mesures provoquent l'hostilité croissante de la bourgeoisie libérale, attachée à la Charte et aux libertés publiques.
Après la chute de Villèle (1827), Charles X tente d'apaiser les tensions, mais la situation économique se dégrade. Les élections de 1830 donnent la victoire aux libéraux, menés par Laffitte et Guizot, favorables à une monarchie parlementaire.
Le roi, refusant de céder, nomme le prince de Polignac, réactionnaire impopulaire, comme chef du gouvernement.
C'est une erreur fatale.
Charles X signe quatre ordonnances qui suspendent la liberté de la presse, dissolvent la Chambre, restreignent le corps électoral et convoquent de nouvelles élections sous contrôle royal. Ces actes violent ouvertement la Charte constitutionnelle.
En réaction, Paris se soulève. La presse et les ouvriers dressent des barricades : c'est la révolution de Juillet. Les insurgés s'emparent du Louvre et des Tuileries. L'armée refuse de tirer sur le peuple.
Le 2 août 1830, Charles X abdique à Rambouillet en faveur de son petit-fils, le duc de Bordeaux (le futur "Henri V"). Mais la Chambre des députés refuse cette succession.
La Maison d'Orléans (1830–1848)
(La monarchie bourgeoise de Louis-Philippe Ier)
Louis-Philippe Ier, roi des Français (1830–1848)
Après la révolution des Trois Glorieuses (27–29 juillet 1830), la branche aînée des Bourbons est écartée. La Chambre des députés choisit Louis-Philippe d'Orléans, cousin des Bourbons et descendant de Philippe Égalité, pour monter sur le trône.
Il devient "roi des Français" et non "roi de France", signe d'un pouvoir fondé sur la volonté nationale plutôt que sur le droit divin. C'est le début de la monarchie de Juillet, régime constitutionnel et libéral.
Louis-Philippe se veut moderne et bourgeois :
- Il vit simplement au palais des Tuileries, vêtu comme un bourgeois.
- Il adopte la devise : "Enrichissez-vous par le travail et l'économie."
- Le drapeau tricolore remplace le drapeau blanc royaliste.
Son régime repose sur la bourgeoisie d'affaires et le suffrage censitaire (seuls les plus riches votent), ce qui limite la participation politique.
Sous son règne :
- La France connaît une forte croissance industrielle (chemins de fer, banques, presse).
- La politique extérieure est prudente (neutralité dans les conflits européens).
- Mais le pouvoir reste fermé, réservé à une élite fortunée.
Cette "monarchie bourgeoise" suscite le mécontentement :
- des républicains, qui veulent la souveraineté populaire,
- des ouvriers, victimes des crises sociales,
- des légitimistes, fidèles aux Bourbons déchus.
En février 1848, une crise économique et la censure des banquets réformistes déclenchent une insurrection à Paris. Louis-Philippe abdique le 24 février 1848 et s'enfuit en Angleterre.
La Deuxième République est proclamée. C'est la fin de la monarchie en France.
La Maison Bonaparte (1852–1870)
(Du Prince-Président à l'Empereur des Français – entre autorité et modernité)
Napoléon III (1852-1870)
Charles-Louis Napoléon Bonaparte naît en 1808, fils de Louis Bonaparte, roi de Hollande, et de Hortense de Beauharnais, belle-fille de Napoléon Ier. Exilé après la chute de l'Empire, il grandit en Suisse et en Italie, nourri du mythe napoléonien et d'un idéal social inspiré du progrès.
Il tente deux coups d'État (à Strasbourg en 1836, puis à Boulogne en 1840), tous deux échoués. Emprisonné au fort de Ham, il s'évade en 1846 et s'exile à Londres. Mais le nom de Napoléon reste populaire en France, surtout chez les paysans et les anciens soldats.
Après la chute de Louis-Philippe, la Deuxième République est proclamée. Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon est élu président de la République au suffrage universel masculin — un raz-de-marée : plus de 5 millions de voix contre 1,4 million pour Cavaignac. Son nom incarne à la fois ordre, gloire et progrès social.
Mais la Constitution lui interdit de briguer un second mandat. Craignant de perdre le pouvoir, il prépare un coup d'État.
Le 2 décembre 1851, date symbolique de la victoire d'Austerlitz, il dissout l'Assemblée nationale, fait arrêter ses opposants et prend le pouvoir. Le plébiscite qui suit lui donne sept millions de "oui" : la France approuve massivement le changement de régime.
Le 2 décembre 1852, il se fait proclamer Empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Le Second Empire est né.
Napoléon III concentre les pouvoirs :
- il nomme et révoque les ministres,
- contrôle la presse et les élections,
- surveille les opposants (républicains et légitimistes),
- maintient l'ordre grâce à une administration centralisée et à la police politique.
La devise du régime : "L'Empire, c'est la paix."
Mais il s'appuie sur un plébiscite populaire et un discours de modernisation, séduisant pour la majorité des Français :
- Développement du chemin de fer (de 3 000 à 17 000 km de voies).
- Création de grandes banques (Crédit mobilier, Crédit foncier).
- Expansion du commerce et de l'industrie.
Transformation urbaine :
- Haussmann refait Paris (grands boulevards, égouts, éclairage au gaz).
- Début de la révolution agricole et de l'essor de la presse populaire.
Napoléon III veut restaurer la grandeur française :
- Guerre de Crimée (1854–1856) : victoire avec les Anglais et les Sardes contre la Russie, prestige retrouvé.
- Campagne d'Italie (1859) : victoire à Magenta et Solférino, création du royaume d'Italie (mais refroidissement avec le pape).
- Expéditions lointaines : Algérie, Mexique, Indochine, Sénégal — début d'un empire colonial moderne.
Le Second Empire atteint alors son apogée politique et économique.
Après 1860, Napoléon III comprend que la société française change. Il assouplit progressivement le régime :
- liberté de la presse,
- droit de réunion,
- rôle accru du Parlement,
- ouverture aux républicains modérés.
C'est le "libéralisme impérial", voulu par son épouse l'impératrice Eugénie et par le ministre Émile Ollivier. L'Empereur se veut désormais le garant d'un Empire démocratique et social.
Mais cette évolution affaiblit son autorité auprès des conservateurs, sans satisfaire pleinement l'opposition.
Expédition désastreuse : Napoléon III veut y créer un empire latin catholique, mais l'empereur Maximilien qu'il installe est fusillé par les républicains mexicains. L'armée française en ressort humiliée.
Le chancelier Bismarck provoque la France par la dépêche d'Ems. Sous la pression de l'opinion, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse (19 juillet 1870).
Mais la France est mal préparée. Le 2 septembre 1870, l'armée française est écrasée à Sedan, et l'empereur est fait prisonnier. Deux jours plus tard, à Paris, la foule proclame la Troisième République.
Napoléon III est exilé en Angleterre, à Chislehurst, avec l'impératrice Eugénie et leur fils, le prince impérial Napoléon-Louis. Il meurt le 9 janvier 1873, des suites d'une opération. Son fils unique mourra à son tour en 1879, tué au Zoulouland, mettant fin à la lignée directe des Bonaparte.
Les prétendants au trône de France depuis 1870
(De la fin de la monarchie à la survivance dynastique)
Le comte de Chambord (1820–1883)
Henri d'Artois, duc de Bordeaux, naît en 1820, petit-fils de Charles X. Il devient héritier du trône après l'abdication de son grand-père en 1830, sous le nom de "Henri V" pour ses partisans légitimistes.
Élevé en exil à la cour d'Autriche, il incarne pour ses partisans le roi chrétien et traditionnel que Dieu aurait choisi.
Après la chute de Napoléon III, la France de 1871 est divisée entre monarchistes et républicains. La majorité monarchiste de l'Assemblée nationale souhaite restaurer la monarchie et offre la couronne à Henri d'Artois.
Mais il refuse de régner sous le drapeau tricolore, symbole de la Révolution, et exige le retour du drapeau blanc des Bourbons : « Je ne puis abandonner le drapeau d'Henri IV et de Jeanne d'Arc pour celui de la Révolution. »
Ce refus, appelé "l'affaire du drapeau", fait échouer la restauration. Les monarchistes reportent alors la couronne sur la Maison d'Orléans, censée succéder après la mort d'Henri.
Henri meurt en exil en 1883, sans enfants. Avec lui s'éteint la branche aînée des Bourbons issue de Louis XIV par son petit-fils Philippe V d'Espagne.
Mais les légitimistes reportent leurs droits sur la Maison d'Espagne, issue des Bourbons espagnols.
Les deux branches rivales : Bourbons et Orléans
Après 1883, la France a deux prétendants distincts au trône. Selon le droit dynastique strict, la succession revient à Jean de Bourbon, comte de Montizón (1822–1887), descendant de Philippe V d'Espagne (petit-fils de Louis XIV). Ses successeurs se font appeler "rois de France" par leurs partisans. Cette lignée, dite "carlisto-légitimiste", mène aujourd'hui jusqu'à Louis de Bourbon, duc d'Anjou, actuel Louis XX pour ses partisans.
Les orléanistes, eux, considèrent que Philippe V, devenu roi d'Espagne, a renoncé à la couronne de France lors du traité d'Utrecht (1713). Ils reconnaissent donc comme héritier le descendant de Louis-Philippe Ier, dernier roi des Français. Cette lignée mène aujourd'hui jusqu'à Jean d'Orléans, comte de Paris, actuel Jean IV pour ses partisans.
Ainsi, depuis la fin du XIXᵉ siècle, la France monarchiste se divise entre :
- les légitimistes, pour les Bourbons d'Espagne (drapeau blanc, "roi de France"),
- les orléanistes, pour les Orléans (drapeau tricolore, "roi des Français").
Les Bonaparte après 1870
Fils unique de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, le prince impérial Louis-Napoléon devient chef de la Maison impériale à la chute de l'Empire. Élevé en Angleterre, il s'engage dans l'armée britannique et meurt en 1879 lors d'une expédition contre les Zoulous en Afrique du Sud. Sa mort tragique met fin à la lignée directe des empereurs.
Les bonapartistes désignent alors le prince Napoléon-Jérôme (1822–1891), cousin de Napoléon III, comme chef de la famille. Sa descendance directe mène aujourd'hui à Jean-Christophe Napoléon (né en 1986), arrière-arrière-petit-neveu de Napoléon Ier, considéré par les bonapartistes comme "Napoléon VII".
Les prétendants contemporains
Aujourd'hui, la France est une République (depuis 1870), mais les trois grandes familles continuent d'entretenir leur héritage historique et symbolique.
Louis de Bourbon (Louis XX) :
- Né en 1974 à Madrid.
- Descendant direct de Louis XIV par Philippe V d'Espagne.
- Titre : duc d'Anjou.
- Chef de la Maison de Bourbon et prétendant légitimiste au trône de France.
- Devise de ses partisans : "Dieu et le Roi."
- Porte le drapeau blanc et revendique la légitimité dynastique intégrale.
Jean d'Orléans (Jean IV)
- Né en 1965.
- Descendant de Louis-Philippe Ier, dernier roi des Français.
- Titre : comte de Paris.
- Chef de la Maison d'Orléans, prétendant orléaniste.
- Prône une monarchie constitutionnelle et républicaine dans l'esprit, proche des valeurs modernes.
- Représente une vision libérale et nationale du royalisme.
Jean-Christophe Napoléon (Napoléon VII)
- Né en 1986.
- Descendant direct de Jérôme Bonaparte, frère de Napoléon Ier.
- Arrière-petit-fils de Victor Napoléon, prétendant au trône impérial.
- Diplômé d'HEC, marié à la princesse Olympia von Arco-Zinneberg (descendante d'un frère de Marie-Antoinette).
- Pour ses partisans, il incarne une possible "renaissance impériale modernisée".
Héritage symbolique
Aujourd'hui, aucune de ces lignées ne détient de pouvoir politique, mais elles conservent un rôle mémoriel et culturel : elles participent à des cérémonies historiques, défendent des œuvres caritatives et patrimoniales. Elles incarnent trois visions différentes de la monarchie française : la tradition et la foi (Bourbons), la nation et la modernité (Orléans), le prestige et le mérite (Bonapartes).