L'Histoire de la Monarchie Britannique
Cette page explore l'évolution fascinante de la monarchie britannique, en commençant par la maison de Wessex jusqu'à la dynastie Windsor et le prince George en 2013. Découvrez les moments clés, les figures emblématiques et les événements marquants qui ont façonné l'histoire royale du Royaume-Uni à travers les siècles.
L'histoire des souverains britanniques de 927 à 1066
(De la maison de Wessex à la conquête normande)
Athelstan (924–939) — Le premier roi d'Angleterre unifiée
Fils du roi Edward l'Ancien et petit-fils d'Alfred le Grand, Athelstan est considéré par les historiens comme le premier roi d'Angleterre au sens moderne. Son accession au trône, en 924, marque l'achèvement de l'œuvre de son grand-père : l'unification des anciens royaumes anglo-saxons (Wessex, Mercie, Northumbrie, Kent, etc.) et des territoires reconquis sur les Danois.
En 927, Athelstan s'empare de la Northumbrie, dernier royaume indépendant, et devient « roi de toute l'Angleterre ».
Son autorité s'étend jusqu'au pays de Galles et à l'Écosse, dont les rois reconnaissent sa suzeraineté. En 937, il triomphe d'une coalition de Vikings, d'Écossais et d'Irlandais à la bataille de Brunanburh, victoire décisive qui confirme l'unité anglaise.
Athelstan fut aussi un souverain érudit et pieux. Il promut la justice, encouragea la diffusion de la loi écrite, et entretint des relations diplomatiques avec les plus grandes cours d'Europe, notamment celles d'Allemagne et de France. Son règne donna à l'Angleterre une identité politique, juridique et chrétienne durable.
Il meurt en 939, sans héritier direct, laissant un royaume consolidé mais encore menacé par les ambitions scandinaves.
Edmond Ier (939–946) — Le protecteur du royaume
Son demi-frère Edmond Ier, encore jeune, lui succède. Dès le début de son règne, il doit affronter la résurgence des invasions vikings : les Danois reprennent la Northumbrie, et il lui faut reconquérir le territoire par la force. Malgré ces troubles, Edmond parvient à restaurer l'unité du royaume avant sa mort prématurée, poignardé lors d'un banquet en 946.
Il est souvent vu comme un roi énergique et juste, soucieux d'ordre et de christianisme. Sous lui, l'autorité du roi s'enracine davantage dans tout le royaume.
Eadred (946–955) — L'unité consolidée
À la mort d'Edmond, son frère Eadred monte sur le trône. Son règne est dominé par la lutte contre les rois vikings de Northumbrie, qui tentent de reprendre leur indépendance. Grâce à une campagne militaire méthodique, Eadred parvient à soumettre définitivement le Nord, plaçant la Northumbrie sous contrôle anglo-saxon.
Il consolide le pouvoir royal et renforce les liens entre l'Église et la monarchie, appuyant la réforme monastique dirigée par saint Dunstan. Malade et sans descendance, Eadred meurt en 955, laissant un royaume stable et uni.
Eadwig (955–959) — Un règne troublé
Le trône revient alors à Eadwig, fils aîné du défunt Edmond Ier. Son règne est bref et marqué par les divisions : les nobles du royaume se révoltent, mécontents de son favoritisme et de son mépris des conseils du clergé. Une partie du royaume (la Mercie et le Nord) se détache même pour se placer sous l'autorité de son frère cadet, Edgar.
Eadwig tente de maintenir son pouvoir, mais il meurt en 959, à seulement 19 ans. Son règne laisse une image de jeunesse et d'inexpérience, contrastant avec celui de son frère qui lui succède.
Edgar le Pacifique (959–975) — L'âge d'or du royaume
Le règne d'Edgar marque une ère de prospérité et d'ordre. Surnommé le Pacifique non parce qu'il fut faible, mais parce qu'il régna sans guerre majeure, Edgar renforce l'administration, réforme la monnaie, la justice et favorise la réforme bénédictine des monastères.
Son pouvoir est reconnu dans tout le royaume. En 973, son couronnement solennel à Bath, célébré dans un faste inspiré du rite impérial, symbolise la maturité du royaume anglais. Selon la légende, huit rois mineurs d'Écosse et du pays de Galles auraient ramé sur la Tamise pour lui témoigner leur soumission.
Sous son autorité, l'Angleterre devient un royaume stable, prospère et centralisé, un modèle pour toute l'Europe du Nord. Edgar meurt en 975, laissant deux fils : Édouard et Æthelred.
Édouard le Martyr (975–978) — La crise dynastique
À la mort d'Edgar, le trône revient à son fils aîné, Édouard, adolescent. Mais sa légitimité est contestée par les partisans de son demi-frère cadet, Æthelred. Le royaume se divise, et trois ans plus tard, en 978, Édouard est assassiné à Corfe, probablement sur ordre de la faction rivale. Son corps est inhumé à Shaftesbury, et sa mort est perçue comme un crime sacrilège : il sera canonisé plus tard comme saint Édouard le Martyr.
Cet épisode tragique ouvre la voie à un long règne troublé.
Æthelred II le Malavisé (978–1016) — Le chaos viking
Fils cadet d'Edgar, Æthelred II, surnommé the Unready (du vieil anglais unræd, "mal conseillé"), hérite d'un royaume instable. Son règne, l'un des plus longs du XIᵉ siècle, est marqué par une succession de catastrophes : les raids vikings reprennent avec une intensité sans précédent.
Plutôt que de combattre efficacement, Æthelred tente d'acheter la paix en versant de lourds tributs aux envahisseurs, le fameux Danegeld. Cette politique d'apaisement ruine le royaume et n'empêche pas les attaques. En 1013, le roi danois Sven à la Barbe Fourchue envahit l'Angleterre. Æthelred s'enfuit en Normandie, où il trouve refuge auprès du duc Richard II, dont il avait épousé la sœur, Emma de Normandie.
Après la mort de Sven, Æthelred revient brièvement au pouvoir en 1014, mais il meurt en 1016, au moment où les Danois envahissent de nouveau.
Edmond II "Ironside" (1016) — Le dernier grand défenseur anglo-saxon
Fils d'Æthelred, Edmond Ironside ("le Côté de fer") hérite d'un royaume envahi par les armées du Danois Canut le Grand. Courageux et énergique, il livre plusieurs batailles héroïques contre l'envahisseur, notamment à Assandun, où il subit finalement la défaite décisive en octobre 1016.
Un accord est conclu : Edmond conserve la moitié du royaume (le Wessex), tandis que Canut règne sur le Nord. Mais quelques semaines plus tard, Edmond meurt mystérieusement, peut-être assassiné, et Canut devient roi d'Angleterre à part entière.
Canut le Grand (1016–1035) — Le roi danois d'Angleterre
Bien qu'étranger à la lignée de Wessex, Canut (ou Knut) gouverne avec habileté. Il consolide l'administration anglaise, respecte les lois anglo-saxonnes et maintient la paix. Son règne marque l'apogée d'un empire nordique englobant le Danemark, la Norvège et l'Angleterre. Canut épouse Emma de Normandie, veuve d'Æthelred, assurant ainsi une continuité dynastique.
À sa mort en 1035, il laisse un royaume prospère, mais son empire éclate entre ses fils.
Harold Ier Pied-de-Lièvre (1035–1040) et Harthacanute (1040–1042)
Le fils illégitime de Canut, Harold Pied-de-Lièvre, usurpe la couronne au détriment de son demi-frère légitime, Harthacanute, fils de Canut et d'Emma. Harold règne de manière autoritaire jusqu'à sa mort en 1040. Harthacanute lui succède, réunissant à nouveau l'Angleterre et le Danemark, mais il meurt brutalement en 1042, sans héritier.
Avec sa mort, la dynastie danoise s'éteint, et la couronne retourne à la maison de Wessex.
Édouard le Confesseur (1042–1066) — Le dernier roi anglo-saxon
Édouard le Confesseur, fils d'Æthelred II et d'Emma de Normandie, monte sur le trône en 1042. Son règne marque un retour à la stabilité et une profonde religiosité. Élevé en Normandie, il introduit à la cour anglaise plusieurs coutumes et conseillers normands, suscitant parfois la méfiance des seigneurs saxons.
Son plus grand legs demeure la fondation de l'abbaye de Westminster, qui deviendra le sanctuaire des rois d'Angleterre. Pieusement respecté, Édouard est canonisé au XIIᵉ siècle.
Mais son absence d'héritier ouvre une crise dynastique majeure : il aurait promis la couronne à Guillaume, duc de Normandie, tout en ayant reconnu les droits du comte Harold Godwinson, son plus puissant vassal.
Harold II Godwinson (janvier–octobre 1066) — Le dernier roi saxon
À la mort d'Édouard, Harold est élu roi par le Witenagemot (assemblée des nobles). Son court règne est marqué par deux invasions : celle du Norvégien Harald Hardrada, qu'il bat à Stamford Bridge, et celle de Guillaume de Normandie, qui revendique le trône. Le 14 octobre 1066, Harold tombe à la bataille de Hastings, frappé d'une flèche à l'œil selon la tradition. Sa mort met fin à plus de cinq siècles de royauté anglo-saxonne et ouvre la voie à la conquête normande.
L'histoire des souverains britanniques de 1066 à 1485
(De Guillaume le Conquérant à Richard III : L'Angleterre des Rollonides à la maison d'York)
La Maison de Normandie (1066–1154)
(Dite "Rollonide", issue de Rollon, duc de Normandie)
Guillaume Ier "le Conquérant" (1066–1087)
Le 14 octobre 1066, à Hastings, Guillaume, duc de Normandie, triomphe de Harold II et devient Guillaume Ier d'Angleterre, surnommé le Conquérant. Sa victoire marque la fin de l'ère anglo-saxonne et le début d'un nouveau régime féodal inspiré du modèle normand.
Guillaume introduit une aristocratie nouvelle, remplaçant presque toute la noblesse anglaise par des seigneurs normands. Il centralise le pouvoir royal : les vassaux lui doivent fidélité directe, sans intermédiaires. Son œuvre administrative culmine en 1086 avec le Domesday Book, immense recensement des terres et richesses du royaume. Mais son règne reste marqué par des révoltes saxonnes écrasées dans le sang, notamment dans le Nord (Harrying of the North).
À sa mort, il partage ses possessions : son fils Robert Courteheuse reçoit la Normandie, et Guillaume II l'Angleterre.
Guillaume II "le Roux" (1087–1100)
Surnommé le Roux en raison de sa chevelure rousse, Guillaume II poursuit la politique autoritaire de son père. Il combat les révoltes de barons, impose son autorité à l'Église et se heurte à Anselme de Cantorbéry, archevêque réformateur. Ambitieux et impulsif, il étend son contrôle sur la Normandie et la Bretagne.
En 1100, il meurt accidentellement (ou mystérieusement) lors d'une chasse dans la forêt de New Forest. Son frère cadet, Henri, s'empare aussitôt du trône.
Henri Ier Beauclerc (1100–1135)
Henri, surnommé Beauclerc pour son érudition, réconcilie le royaume avec l'Église et restaure l'ordre. Il fonde une administration centralisée (Trésor royal, chancellerie) et favorise une justice écrite. Il épouse Mathilde d'Écosse, d'ascendance anglo-saxonne, consolidant ainsi la légitimité de la dynastie.
Son seul fils légitime, Guillaume Adelin, meurt noyé dans la Blanche-Nef en 1120, tragédie qui plonge le royaume dans une crise successorale. Henri désigne alors sa fille, l'Impératrice Mathilde, comme héritière — décision que les barons refusent d'accepter à sa mort.
Étienne de Blois (1135–1154) - petit-fils de Guillaume le Conquérant
Cousin de Mathilde, Étienne s'empare du trône, déclenchant une guerre civile connue sous le nom de l'Anarchie (1135–1153). Pendant vingt ans, le royaume est ravagé par les affrontements entre les partisans d'Étienne et ceux de l'impératrice Mathilde.
Le conflit s'achève en 1153 par le traité de Wallingford : Étienne conserve la couronne à vie, mais reconnaît comme héritier le fils de Mathilde, Henri Plantagenêt, comte d'Anjou.
À la mort d'Étienne, en 1154, la couronne passe donc à Henri II, inaugurant une nouvelle dynastie.
La Maison d'Anjou-Plantagenêt (1154–1399)
Henri II Plantagenêt (1154–1189)
Fils de Geoffroy Plantagenêt et de l'Impératrice Mathilde, Henri II fonde une dynastie puissante, régnant non seulement sur l'Angleterre, mais aussi sur un vaste empire continental : l'empire Plantagenêt, qui s'étend de l'Écosse aux Pyrénées.
Henri II réforme profondément la justice : il instaure le common law, fonde les jurys populaires et limite l'arbitraire féodal. Mais son règne est assombri par son conflit avec Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, qu'il avait lui-même nommé. L'assassinat de Becket en 1170 provoque un scandale européen.
Henri meurt en 1189, trahi par ses fils, dont Richard et Jean.
Richard Ier "Cœur de Lion" (1189–1199)
Guerrier avant tout, Richard Cœur de Lion passe à peine six mois de son règne en Angleterre. Il part pour la Troisième Croisade (1189–1192), où il combat Saladin avec bravoure. Fait prisonnier sur le chemin du retour, il est libéré contre rançon. Malgré son absence, il préserve l'administration solide de son père. Il meurt en 1199, blessé lors d'un siège en France, sans héritier légitime.
Jean Ier "sans Terre" (1199–1216)
Frère de Richard, Jean hérite du trône mais perd rapidement les territoires continentaux hérités de ses ancêtres : Normandie (1204), Anjou, Maine et Touraine. Ces pertes lui valent son surnom de sans Terre. Son autoritarisme et sa fiscalité écrasante suscitent la révolte des barons. En 1215, il est contraint de signer la Magna Carta, premier texte limitant le pouvoir royal et reconnaissant des droits aux sujets. Jean meurt l'année suivante, laissant le trône à son fils de neuf ans.
Henri III (1216–1272)
Fils de Jean, Henri III règne plus de cinquante ans, marquant un retour relatif à la stabilité. Il encourage l'art gothique (construction de Westminster Abbey) et renforce la monarchie, mais ses favoritismes étrangers provoquent de nouvelles révoltes. La guerre civile éclate sous la conduite de Simon de Montfort, qui convoque en 1265 le premier Parlement représentatif d'Angleterre, ancêtre de la Chambre des Communes.
Henri reprend le contrôle mais son autorité est affaiblie à sa mort.
Édouard Ier "Longshanks" (1272–1307)
Édouard Ier est un roi réformateur et conquérant. Il soumet le pays de Galles (1284), fortifie la frontière par des châteaux monumentaux (Conwy, Caernarfon) et impose son autorité à l'Écosse, provoquant la résistance de William Wallace. Il réorganise les lois et institutionnalise le Parlement en 1295, réunissant nobles, clergé et représentants des comtés.
Son règne jette les bases du royaume d'Angleterre médiéval.
Édouard II (1307–1327)
Fils d'Édouard Ier, Édouard II manque d'énergie et s'aliène la noblesse par ses favoris, notamment Piers Gaveston. Battu par les Écossais à Bannockburn (1314), il perd le contrôle du Nord et l'estime de ses barons. Renversé par son épouse Isabelle de France et son amant Roger Mortimer, il est emprisonné puis assassiné en 1327.
Édouard III (1327–1377)
Sous Édouard III, l'Angleterre retrouve sa vigueur. Il revendique le trône de France par sa mère Isabelle et déclenche en 1337 la Guerre de Cent Ans. Son règne voit la victoire légendaire de Crécy (1346) et la fondation de l'ordre de la Jarretière. Mais le royaume est frappé en 1348 par la Peste noire, qui décime un tiers de la population.
Malgré cela, le prestige anglais atteint son apogée. Édouard meurt en 1377, laissant un empire glorieux mais financièrement affaibli.
Richard II (1377–1399)
Petit-fils d'Édouard III, Richard II monte sur le trône enfant. Son règne débute dans la tourmente : en 1381, la Révolte des paysans secoue l'Angleterre. Devenu adulte, Richard tente d'imposer une monarchie autoritaire, provoquant l'opposition de ses cousins, les Lancastre. En 1399, son cousin Henri Bolingbroke le renverse et devient roi sous le nom d'Henri IV. Richard meurt en captivité, sans héritier : la maison de Lancastre accède au trône.
La Maison de Lancastre (1399–1461 ; 1470–1471)
Henri IV (1399–1413)
Premier roi Lancastre, Henri IV consolide son pouvoir après avoir usurpé la couronne. Il affronte plusieurs révoltes, notamment celle des gallois dirigés par Owain Glyndŵr. Son règne est difficile, marqué par la maladie et la défiance des nobles.
Henri V (1413–1422)
Son fils Henri V incarne l'idéal du roi chevalier. Il relance la guerre contre la France et remporte la célèbre bataille d'Azincourt (1415). Par le traité de Troyes (1420), il devient héritier du trône de France et épouse Catherine de Valois. Il meurt prématurément en 1422, laissant un nourrisson roi des deux royaumes.
Henri VI (1422–1461, puis 1470–1471)
Henri VI, fils d'Henri V, n'a que neuf mois lorsqu'il hérite des trônes d'Angleterre et de France. Roi pieux mais faible, il perd la France (défaite face à Jeanne d'Arc) et voit l'Angleterre sombrer dans la crise. Ses accès de folie ouvrent la voie à la Guerre des Deux-Roses (1455–1487), conflit dynastique opposant Lancastre (rouge) et York (blanc). Renversé en 1461 par Édouard IV, Henri est brièvement restauré en 1470 avant d'être assassiné l'année suivante dans la Tour de Londres.
La Maison d'York (1461–1470 ; 1471–1485)
Édouard IV (1461–1470, 1471–1483)
Descendant d'Édouard III, Édouard IV est un roi énergique et habile. Il triomphe des Lancastre à Towton (1461) et s'impose comme souverain légitime. Son règne apporte la paix intérieure et la prospérité économique, soutenue par la puissance de Londres et des marchands. Cependant, une révolte menée par son ancien allié Warwick le Faiseur de rois le renverse en 1470, avant qu'il ne reprenne le pouvoir l'année suivante.
Édouard meurt subitement en 1483, laissant deux fils mineurs, Édouard et Richard.
Édouard V (avril–juin 1483)
Âgé de 12 ans, Édouard V ne règne que quelques semaines. Son oncle, Richard (futur Richard III), duc de Gloucester, assure la régence, puis fait enfermer Édouard et son frère dans la Tour de Londres. Les deux enfants disparaissent mystérieusement : ce sont les "Princes de la Tour", dont le destin reste un mystère historique.
Richard III (1483–1485)
Couronné après avoir déclaré illégitime les fils d'Édouard IV, Richard III règne en tyran soupçonneux. Malgré certaines réformes judiciaires, il est détesté pour son usurpation. En 1485, il affronte l'armée d'Henri Tudor, héritier des Lancastre, à la bataille de Bosworth. Richard meurt au combat, le dernier roi d'Angleterre à tomber sur le champ de bataille.
Sa mort met fin à la maison d'York et à la Guerre des Deux-Roses. Henri Tudor devient Henri VII, inaugurant la maison des Tudor et une nouvelle ère de stabilité.
La Maison Tudor (1485–1603)
(De Henri VII à Élisabeth Iʳᵉ – l'émergence de l'Angleterre moderne)
Henri VII (1485–1509)
Fils de Marguerite Beaufort (descendante des Lancastre), Henri Tudor devient roi en 1485 après avoir vaincu Richard III à la bataille de Bosworth. Son avènement met fin à la Guerre des Deux-Roses, conflit qui avait déchiré l'aristocratie anglaise pendant trente ans.
Pour consolider sa légitimité, Henri épouse Élisabeth d'York, fille d'Édouard IV, union symbolique des deux roses, la rouge (Lancastre) et la blanche (York), devenant l'emblème des Tudors.
Henri VII restaure l'ordre et renforce l'autorité royale. Il rétablit la stabilité financière du royaume après des décennies de guerre : il surveille étroitement les nobles, réprime les révoltes et centralise les impôts. Son Conseil privé, dominé par des juristes plutôt que des barons, marque la naissance d'un gouvernement bureaucratique moderne.
Henri fonde aussi la Cour de l'Étoile (Star Chamber), tribunal chargé de juger les abus des puissants. Soucieux d'éviter les aventures extérieures, il maintient la paix, scelle des alliances dynastiques (mariage de son fils Arthur avec Catherine d'Aragon, fille des Rois Catholiques) et laisse à sa mort un trésor bien rempli.
Il lègue à son fils un royaume stable et riche — un héritage que Henri VIII saura exploiter… à sa manière.
Henri VIII (1509–1547)
Fils d'Henri VII, Henri VIII accède au trône à dix-huit ans. Beau, érudit et athlétique, il incarne l'idéal du prince de la Renaissance. Son début de règne est prometteur : il réorganise la cour, protège les arts et s'entoure d'humanistes comme Thomas More et Thomas Wolsey.
Mais derrière l'apparence du roi lettré se cache un monarque ambitieux et autoritaire.
Marié à Catherine d'Aragon, veuve de son frère Arthur, Henri n'obtient d'elle qu'une fille, Marie. Souhaitant un héritier mâle, il demande au pape Clément VII l'annulation de son mariage. Face au refus pontifical, Henri rompt avec Rome.
Par les Actes de Suprématie (1534), il se proclame Chef suprême de l'Église d'Angleterre, une rupture capitale dans l'histoire du christianisme occidental. La Réforme anglaise est née, distincte du protestantisme continental mais détachée de l'autorité papale.
Henri confisque les biens des monastères (1536–1540), enrichissant considérablement la Couronne. Mais il gouverne par la peur : nombre de ses proches, dont Thomas More, Anne Boleyn et Thomas Cromwell, finissent sur l'échafaud.
Ses six mariages symbolisent son tempérament :
- Catherine d'Aragon (divorcée)
- Anne Boleyn (décapitée)
- Jeanne Seymour (morte en couches, mère d'Édouard VI)
- Anne de Clèves (répudiée)
- Catherine Howard (décapitée)
- Catherine Parr (survit au roi)
Henri meurt en 1547, obèse et désabusé, laissant un royaume transformé : le catholicisme a été brisé, la monarchie renforcée, et une nouvelle Église nationale est née.
Édouard VI (1547–1553)
Fils d'Henri VIII et de Jeanne Seymour, Édouard VI monte sur le trône à neuf ans. Sous la régence du duc de Somerset puis du duc de Northumberland, l'Angleterre s'oriente résolument vers le protestantisme.
Le Book of Common Prayer (1549) et la Seconde Loi d'uniformité (1552) imposent la liturgie anglicane en anglais. Les biens de l'Église continuent d'être pillés, et la noblesse protestante s'enrichit.
Mais la crise économique, la misère rurale et les révoltes (notamment celle de Kett) affaiblissent le régime. Édouard, tuberculeux, meurt à 15 ans, laissant un testament qui écarte sa demi-sœur catholique Marie au profit de Lady Jane Grey, sa cousine protestante.
Marie Iʳᵉ Tudor (1553–1558)
Fille de Catherine d'Aragon, Marie rétablit le catholicisme et l'obéissance à Rome. Son accession au trône met fin à l'usurpation de Jane Grey, exécutée après neuf jours de règne.
Mariée à Philippe II d'Espagne, Marie souhaite ramener l'Angleterre dans le giron catholique. Mais sa politique répressive, plus de 280 protestants brûlés vifs, dont Thomas Cranmer, lui vaut le surnom cruel de Bloody Mary.
Elle perd Calais en 1558, dernier bastion anglais sur le continent, symbole de la fin des ambitions françaises. Sans enfant, elle meurt la même année, laissant la couronne à sa demi-sœur Élisabeth, fille d'Anne Boleyn.
Élisabeth Iʳᵉ (1558–1603)
Fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, Élisabeth Iʳᵉ hérite d'un royaume divisé par la religion et la guerre. Femme d'une intelligence rare, prudente et politique, elle rétablit l'équilibre religieux par le Settlement religieux de 1559 :
- Le roi reste chef de l'Église d'Angleterre (Acte de suprématie)
- La liturgie anglicane s'impose (Book of Common Prayer), mais avec une certaine tolérance.
Ce compromis donne naissance à l'anglicanisme, identité religieuse proprement anglaise.
Élisabeth affronte la menace de sa cousine catholique, Marie Stuart, reine d'Écosse, qu'elle fait exécuter en 1587 après de multiples complots. L'année suivante, l'Armada espagnole tente d'envahir l'Angleterre : la flotte d'Élisabeth, menée par Francis Drake, inflige à Philippe II une défaite retentissante (1588).
Ce triomphe fait d'elle la souveraine la plus respectée d'Europe et renforce le sentiment national anglais.
Sous son règne, les arts connaissent un éclat sans précédent. C'est l'époque de Shakespeare, Marlowe, Spenser, Byrd et du rayonnement de la langue anglaise. L'Angleterre devient aussi une puissance maritime : Walter Raleigh et Francis Drake ouvrent la voie aux futures colonies.
Élisabeth meurt en 1603, célibataire et sans héritier, après 45 ans de règne. Sa mort marque la fin de la maison Tudor. La couronne revient à son cousin Jacques VI d'Écosse, fils de Marie Stuart, qui unit les deux royaumes sous le nom de Jacques Ier d'Angleterre, premier des Stuart.
La Maison Stuart (1603–1714)
(De l'union des couronnes à la naissance du Royaume de Grande-Bretagne)
James Ier (1603–1625)
À la mort d'Élisabeth Iʳᵉ en 1603, sans héritier, la couronne d'Angleterre revient à son cousin James VI d'Écosse, fils de Marie Stuart, qu'il n'a jamais connue. Devenant James Ier d'Angleterre (ou Jacques Ier), il unit pour la première fois les deux royaumes sous un même souverain : c'est l'Union des Couronnes.
Bien que l'Angleterre et l'Écosse conservent leurs lois et leurs Parlements distincts, Jacques rêve d'une monarchie unifiée et absolue. Il adopte la devise : "Beati Pacifici" — "Heureux les pacifiques".
Intellectuel raffiné, Jacques patronne les lettres : il commande la Bible du roi Jacques (King James Bible), chef-d'œuvre linguistique encore lu aujourd'hui. Mais sa croyance en le droit divin des rois le met en conflit avec le Parlement, jaloux de ses prérogatives.
Son règne est aussi marqué par la Conspiration des Poudres (1605) : un groupe de catholiques, mené par Guy Fawkes, tente de faire exploser le Parlement. L'attentat échoue, et l'événement devient un symbole du danger catholique.
James meurt en 1625, laissant un royaume prospère mais miné par les tensions religieuses et politiques que son fils, Charles Ier, saura mal apaiser.
Charles Ier (1625–1649)
Fils de James Ier, Charles Ier croit, plus encore que son père, au droit divin. Son mariage avec Henriette-Marie de France, princesse catholique, inquiète ses sujets protestants. Le roi gouverne sans concertation, impose de nouvelles taxes, et tente d'uniformiser la religion anglicane en Écosse : provoquant la colère des presbytériens.
En 1642, après des années de tension, la guerre éclate entre :
- les Cavaliers, partisans du roi
- les Têtes-Rondes (Roundheads), partisans du Parlement, menés par Oliver Cromwell.
Après plusieurs années de combats, les forces parlementaires triomphent. Charles Ier, capturé, est jugé pour trahison, événement sans précédent dans l'histoire européenne et exécuté le 30 janvier 1649 devant Whitehall.
L'Angleterre devient alors une république : le Commonwealth.
La République et le Protectorat de Cromwell (1649–1660)
Après la mort de Charles Ier, le Parlement abolit la monarchie et la Chambre des Lords. L'Angleterre est proclamée République, dirigée par un Conseil d'État. Mais rapidement, les divisions politiques et religieuses sapent le nouveau régime.
Oliver Cromwell, le "Lord Protecteur" (1653–1658)
Cromwell, général victorieux, impose son autorité. Sous son gouvernement, la dictature puritaine, les mœurs sont strictement surveillées : les théâtres ferment, la fête de Noël est interdite, et la tolérance religieuse est très limitée.
Sur le plan militaire, Cromwell brille : il réprime férocement les révoltes en Irlande (massacres de Drogheda et Wexford) et soumet l'Écosse. Son régime, austère mais efficace, fait de l'Angleterre une puissance maritime montante.
À sa mort en 1658, son fils Richard ne parvient pas à lui succéder. En 1660, las de l'instabilité, le pays rappelle le fils du roi exécuté : Charles II. La monarchie est restaurée.
Charles II (1660–1685)
Le retour de Charles II, fils du roi décapité, marque la Restauration de la monarchie. Le peuple l'accueille avec enthousiasme : après vingt ans de rigueur puritaine, Londres retrouve les plaisirs du théâtre, de la musique et de la cour. C'est le temps de Samuel Pepys, de John Dryden, et des salons élégants.
Charles tente de régner avec prudence, mais les tensions religieuses demeurent : le Parlement, dominé par les anglicans, craint un retour du catholicisme. Le roi lui-même entretient une diplomatie ambiguë avec Louis XIV, et se convertira secrètement au catholicisme sur son lit de mort.
Son règne est marqué par deux catastrophes :
- la Grande Peste de Londres (1665),
- le Grand Incendie de Londres (1666), qui détruit la ville médiévale.
Malgré tout, Charles II laisse une Angleterre vivante, cosmopolite, et sur la voie d'un renouveau commercial et maritime.
James II (1685–1688)
Frère de Charles II, James II (James VII d'Écosse - ou Jacques en français) accède au trône à un âge avancé.
Ouvertement catholique, il tente de rétablir la liberté religieuse et d'ouvrir les charges publiques aux catholiques. Mais cette politique suscite la panique des élites protestantes, qui redoutent un retour à la domination romaine.
En 1688, la naissance d'un fils, qui promet une succession catholique, pousse les nobles à agir : ils invitent William (Guillaume) d'Orange, gendre de James et mari de sa fille protestante Marie, à débarquer en Angleterre.
William d'Orange débarque avec une armée ; James II s'enfuit en France. Le Parlement déclare le trône vacant et offre la couronne à William III et Marie II, qui règnent conjointement. Cet événement, connu comme la Glorieuse Révolution, consacre la suprématie du Parlement sur la monarchie.
En 1689, William et Marie signent le Bill of Rights, texte fondamental de la monarchie constitutionnelle anglaise.
Il garantit :
- la liberté du Parlement,
- l'interdiction de toute suspension arbitraire des lois,
- et la nécessité du consentement parlementaire pour lever des impôts ou maintenir une armée permanente.
L'Angleterre devient ainsi une monarchie limitée, où le pouvoir royal est soumis à la loi.
William III (1689–1702) et Marie II (1689–1694)
William et Marie règnent en duo jusqu'à la mort de la reine en 1694. William, d'origine néerlandaise, continue seul à gouverner. Il renforce les alliances protestantes en Europe et lutte contre Louis XIV dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg.
Sous son règne, le Parlement devient une institution stable et prééminente. La Banque d'Angleterre est fondée en 1694, et la monarchie constitutionnelle moderne prend forme.
Anne (1702–1714)
Sœur cadette de Marie II, Anne est la dernière souveraine Stuart. Pieuse et anglicane convaincue, elle voit son règne dominé par la politique européenne et l'union nationale.
Sous le commandement du duc de Marlborough, les armées anglaises remportent d'éclatantes victoires contre la France, notamment à Blenheim (1704). L'Angleterre s'impose comme une puissance militaire et diplomatique majeure.
En 1707, Anne réalise enfin le rêve de Jacques Ier : l'union formelle de l'Angleterre et de l'Écosse au sein du Royaume de Grande-Bretagne. Les deux Parlements fusionnent, et le drapeau de l'Union (l'Union Jack) devient l'emblème du nouveau royaume.
Anne meurt en 1714 sans héritier survivant, après dix-sept grossesses tragiquement infructueuses. La lignée Stuart s'éteint sur le trône britannique. Conformément à l'Acte de Succession (1701), la couronne revient à la maison de Hanovre, issue de la princesse Sophie de Hanovre, descendante des Stuart protestants.
La Maison de Hanovre (1714–1901)
(De l'importation d'un roi allemand à l'âge d'or victorien)
George Ier (1714–1727)
À la mort de la reine Anne en 1714, sans héritier direct, la couronne passe à George, électeur de Hanovre, arrière-petit-fils de James Ier Stuart. Ce choix, dicté par l'Acte de Succession (1701), visait à exclure tout prétendant catholique. Ainsi, un prince allemand de 54 ans, parlant à peine l'anglais, devient George Ier d'Angleterre.
Son arrivée marque le début de l'ère hanovrienne, et du Royaume de Grande-Bretagne, unifié depuis 1707.
George Ier, peu intéressé par les affaires anglaises, laisse la conduite du pays à ses ministres. Ce désengagement favorise la montée d'une nouvelle institution : le cabinet ministériel, dirigé par un Premier ministre responsable devant le Parlement. C'est sous son règne que s'impose Robert Walpole, considéré comme le premier Premier ministre britannique.
Pendant ce temps, les partisans des Stuart exilés, les Jacobites, tentent de restaurer la dynastie déchue : la rébellion de 1715 échoue, consolidant le trône hanovrien.
George II (1727–1760)
Fils de George Ier, Georges II poursuit une politique similaire. S'il parle un peu mieux anglais que son père, il s'appuie lui aussi sur le Parlement et sur Walpole, qui domine la vie politique jusqu'en 1742. Le règne de George II est marqué par une stabilité intérieure remarquable et une expansion coloniale continue.
L'Angleterre s'affirme sur la scène mondiale :
- victoire à Dettingen (1743), où le roi combat personnellement, la dernière fois qu'un monarque britannique dirige une armée sur le champ de bataille ;
- et succès coloniaux dans les Indes et en Amérique du Nord, amorçant l'expansion de l'Empire britannique.
Une nouvelle révolte jacobite éclate en 1745, menée par Charles Édouard Stuart, le "Bonnie Prince Charlie". Elle échoue à Culloden (1746) : la cause des Stuart est définitivement perdue.
George III (1760–1820)
Petit-fils de George II, George III est le premier roi de Hanovre né en Grande-Bretagne et parlant l'anglais comme langue maternelle. Roi pieux et consciencieux, il entend restaurer l'autorité morale de la Couronne.
Sous son règne éclate la Révolution américaine. Les colons, opposés aux taxes imposées sans représentation ("no taxation without representation"), proclament leur indépendance en 1776. Après huit ans de guerre, la Grande-Bretagne reconnaît les États-Unis en 1783, lors du traité de Paris.
Cet échec est un choc, mais il ouvre paradoxalement une ère nouvelle : la Grande-Bretagne réoriente son expansion vers l'Asie, l'Afrique et le Pacifique.
Les dernières décennies du règne voient :
- La Révolution française (1789), puis les guerres napoléoniennes,
- l'essor de l'Empire britannique en Inde et ailleurs,
- et les débuts de la Révolution industrielle, qui bouleverse la société.
George III souffre dans ses dernières années d'une maladie mentale (probablement porphyrie) et abdique de fait en faveur de son fils, régent à partir de 1811. Il meurt en 1820, aveugle et fou, mais respecté.
George IV (1820–1830)
Fils du roi précédent, George IV a déjà régné comme Prince Régent pendant la folie de son père (1811–1820). Homme cultivé mais dissipé, il incarne le luxe et le raffinement du Régency style.
Sous son patronage s'épanouissent les arts et l'architecture (création du Royal Pavilion de Brighton, aménagement de Regent's Park et Regent Street à Londres). Mais ses excès et son divorce scandaleux avec la reine Caroline ternissent son image.
Son règne, bien que court, symbolise le passage du XVIIIᵉ siècle aristocratique à un XIXᵉ siècle plus bourgeois et industriel.
William IV (1830–1837)
Frère cadet de George IV, William IV (Guillaume IV) accède au trône à 65 ans. Moins flamboyant, il se montre plus proche du peuple et accepte des réformes majeures.
La plus importante est le Reform Act de 1832, qui élargit le droit de vote et modernise la représentation parlementaire. C'est une étape clé vers la démocratie parlementaire.
Son règne voit aussi l'abolition progressive de l'esclavage dans l'Empire britannique (1833). William meurt sans descendance légitime en 1837 : la couronne passe à sa nièce, Victoria, qui incarne le renouveau du royaume.
Victoria (1837–1901)
Montée sur le trône à 18 ans, Victoria règne plus de soixante ans, plus longtemps que tout monarque britannique avant elle. Elle épouse son cousin le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, union à la fois amoureuse et politique. Sous leur influence, la monarchie devient morale, familiale, et bourgeoise : un modèle pour la société victorienne.
Le XIXᵉ siècle anglais est celui de la Révolution industrielle : chemins de fer, machines à vapeur, mines, usines et ports transforment le pays en "atelier du monde". Les grandes villes s'étendent, la bourgeoisie triomphe, et le Parlement devient le cœur du pouvoir.
Les réformes politiques successives (1832, 1867, 1884) étendent le suffrage à une grande partie des hommes, tandis que les syndicats et la presse se développent.
Sous Victoria, l'Empire atteint son apogée : l'Inde devient la "perle de la Couronne", l'Afrique et l'Océanie sont explorées et colonisées, le commerce mondial passe par Londres. En 1876, Victoria est proclamée Impératrice des Indes.
C'est aussi le temps de la Grande Exposition de 1851, célébration du progrès industriel, organisée au Crystal Palace par le prince Albert.
Après la mort d'Albert en 1861, Victoria se retire longtemps de la vie publique, avant de redevenir une figure respectée et aimée. Son règne, marqué par la prospérité, la moralité et la puissance impériale, laisse une empreinte indélébile.
À sa mort en 1901, la reine Victoria symbolise un empire sur lequel "le soleil ne se couche jamais". Son fils Édouard VII lui succède, inaugurant la maison de Saxe-Cobourg-Gotha, bientôt rebaptisée Windsor.
La Maison de Saxe-Cobourg-Gotha (1901–1917) et la Maison de Windsor (1917–aujourd'hui)
(De l'Empire au Commonwealth : la monarchie dans le monde moderne)
Edward VII (1901–1910)
Fils de la reine Victoria et du prince Albert, Edward VII attend le trône pendant plus de soixante ans. Homme de plaisirs, grand amateur de mode et de société, il surprend à son avènement par sa rigueur et son sens du devoir.
Son règne inaugure l'ère édouardienne, marquée par une élégance raffinée et un optimisme propre à la Belle Époque.
Edward VII s'attache à renforcer les alliances européennes : il scelle notamment l'Entente cordiale (1904) avec la France, qui met fin à des siècles de rivalité et prépare la coopération franco-britannique de la Première Guerre mondiale.
Sous son règne, le Royaume-Uni demeure la première puissance maritime et coloniale du monde. Mais derrière la prospérité se profilent les tensions sociales et nationales qui secoueront le siècle à venir.
Edward meurt en 1910, très populaire, laissant le trône à son fils George V.
George V (1910–1936)
Petit-fils de Victoria, George V monte sur le trône à une époque d'équilibre fragile. Quand éclate la Première Guerre mondiale, il soutient l'effort national avec dignité, visitant les troupes et partageant les privations du peuple.
Mais un problème symbolique surgit : le roi et sa famille portent un nom à consonance allemande, Saxe-Cobourg-Gotha, alors que le Royaume-Uni combat l'Allemagne.
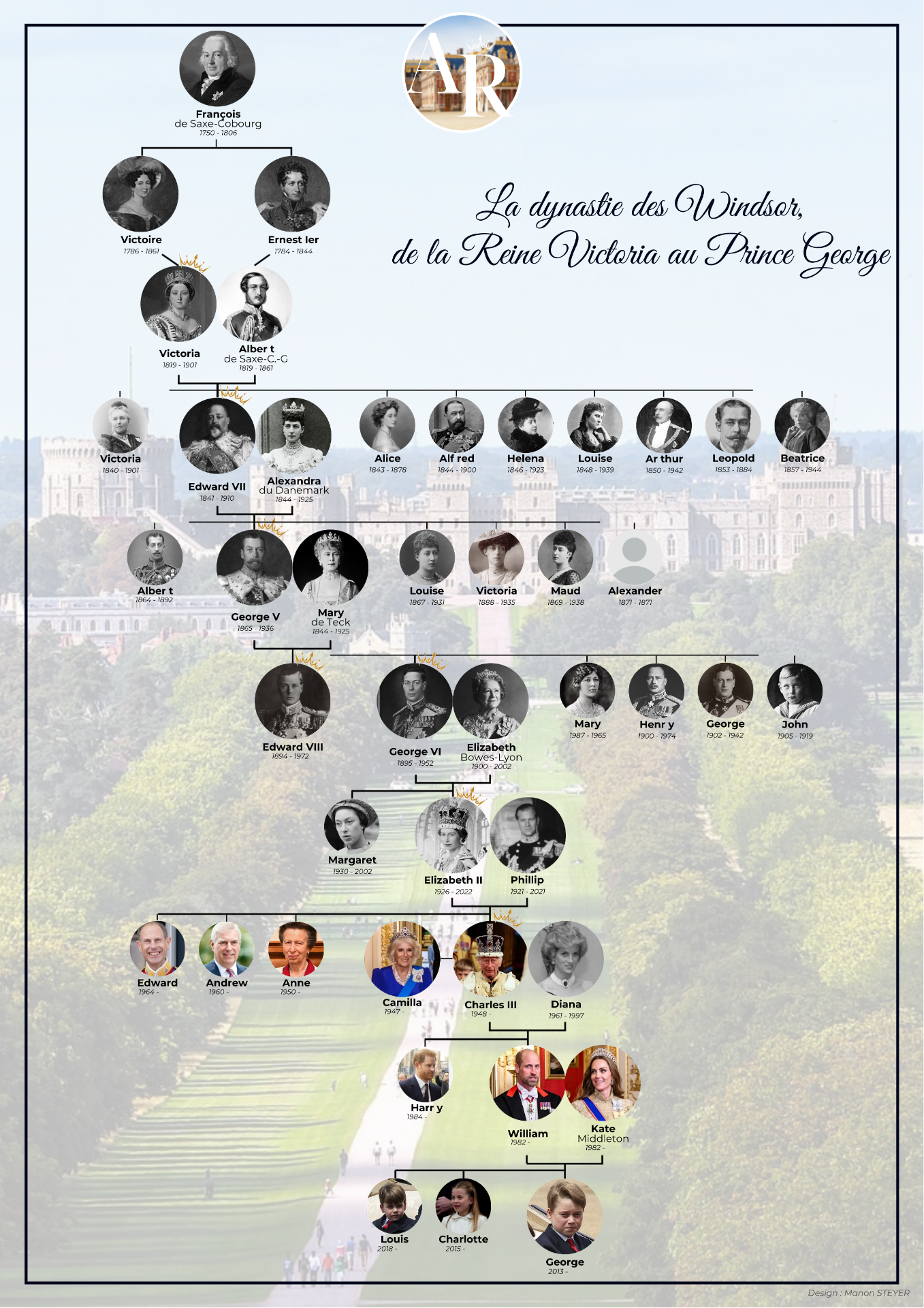
En pleine guerre, George V décide un geste historique : le 17 juillet 1917, il renonce à son nom allemand et rebaptise la dynastie "Maison de Windsor", du nom du vieux château royal. Depuis, Windsor reste le nom officiel de la famille royale britannique.
Le règne de George V voit aussi :
- la montée du Parti travailliste,
- le vote accordé aux femmes (1918–1928),
- et la transformation de l'Empire en Commonwealth britannique (Statut de Westminster, 1931), reconnaissant l'autonomie des dominions comme le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud.
George V meurt en 1936, respecté comme un roi simple, consciencieux et profondément attaché à son peuple.
Edward VIII (janvier–décembre 1936)
L'année 1936, appelée "année des trois rois", reste unique dans l'histoire britannique.
À la mort de George V, son fils aîné Edward VIII monte sur le trône. Charismatique, moderne et populaire, il choque rapidement le gouvernement et l'Église par sa volonté d'épouser Wallis Simpson, Américaine deux fois divorcée.
Le mariage étant jugé incompatible avec son rôle de chef de l'Église d'Angleterre, Edward choisit l'amour : le 11 décembre 1936, il abdique, déclarant à la radio : "J'ai trouvé impossible de porter le lourd fardeau des devoirs de roi sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime."
Son frère cadet devient George VI, et Edward reçoit le titre de duc de Windsor.
George VI (1936–1952)
Timide, bègue, mal préparé, George VI n'était pas destiné à régner. Mais sa dignité, son courage et sa simplicité lui valent l'admiration du peuple, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pendant les bombardements de Londres (le Blitz), George VI et la reine Elizabeth refusent de quitter la capitale. Ils visitent les quartiers dévastés, soutiennent les soldats et symbolisent la résilience nationale.
C'est aussi sous son règne que l'Empire commence sa transformation irréversible : en 1947, l'Inde devient indépendante, marquant le début de la décolonisation.
Après la guerre, le Royaume-Uni émerge affaibli mais moralement renforcé. George VI meurt en 1952, laissant à sa fille aînée un trône chargé d'histoire : Elizabeth II.
Elizabeth II (1952–2022)
Montée sur le trône à 25 ans, Elizabeth II devient le symbole d'une monarchie adaptée au XXᵉ siècle. Son couronnement en 1953 est le premier retransmis à la télévision : un événement mondial.
Durant ses 70 ans de règne, le plus long de l'histoire britannique, elle traverse 15 Premiers ministres, de Churchill à Liz Truss, et incarne la continuité nationale dans un monde en mutation.
Sous son règne, la décolonisation s'achève : les anciennes colonies deviennent indépendantes, mais choisissent pour la plupart de rester unies dans le Commonwealth, communauté volontaire de nations dont la reine est le symbole.
Elle visite plus de 120 pays, devenant l'un des chefs d'État les plus respectés du monde.
Elizabeth II modernise l'image de la Couronne :
- ouverture au public du palais de Buckingham,
- participation active à la vie médiatique,
- et volonté de transparence financière.
Sa longévité et sa constance lui valent une popularité durable, même à travers les crises : la mort de Diana (1997), les tensions familiales, et les débats sur l'avenir de la monarchie.
Elle meurt le 8 septembre 2022, à Balmoral, après 70 ans et 214 jours de règne, un record historique.
Charles III (2022–aujourd'hui)
Né en 1948, Charles III a été prince de Galles pendant plus de 70 ans, l'héritier le plus ancien de l'histoire. Passionné d'écologie avant l'heure, il a longtemps défendu des causes comme la protection de l'environnement, l'agriculture durable et le dialogue interculturel.
Son accession au trône, à 73 ans, symbolise la continuité et la modernisation de l'institution Son couronnement, en 2023, a mêlé tradition et ouverture, avec la participation de représentants de toutes les religions du Royaume-Uni.
Charles III s'efforce de faire de la monarchie une institution utile, sobre et représentative, dans un pays désormais multiculturel et globalisé.
